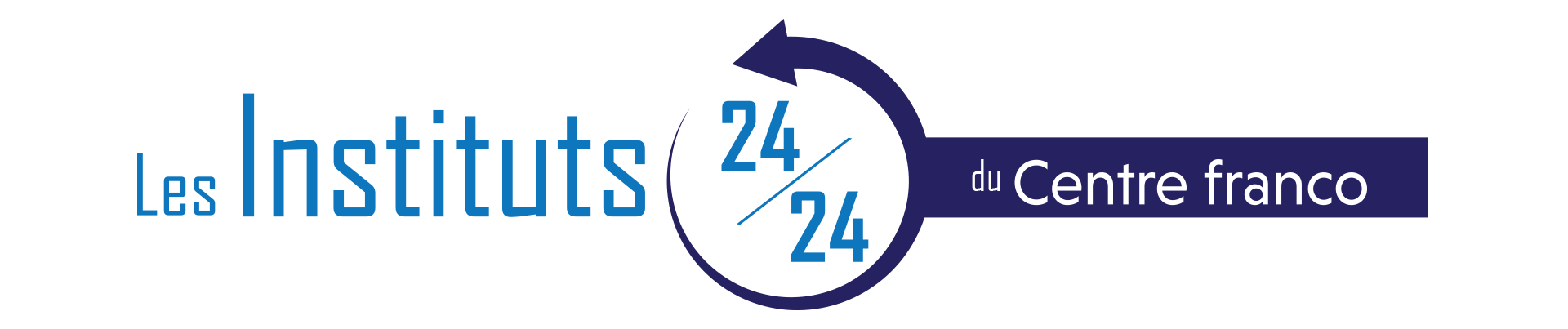À la rencontre de Martin Laporte – L‘importance de l’animation culturelle dans les écoles franco-ontariennes!
Épisode 14
Martin Laporte travaille dans le domaine de l’animation culturelle depuis plus de 20 ans. Il a longtemps été animateur culturel à l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges. Il est maintenant gestionnaire de projets en construction identitaire au CECCE et il travaille de près avec les élèves du réseau des élèves. Il fait partie du Réseau des leaders provinciaux en animation culturelle et organise de multiples activités systémiques et provinciales pour mousser la fierté francophone.
Dans son temps libre, Martin Laporte est membre de la troupe d’improvisation Improtéine et sillonne le pays à la rencontre des communautés francophones.
Le Centre franco est sur Spotify!
Écoutez le balado de Martin Laporte en cliquant sur la première partie et/ou la deuxième partie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode!
1re partie du balado
Martin Laporte : C’est un peu la façon, ma philosophie, dans le fond, c’est que je vais te faire vivre des affaires tellement le fun que tu n’auras pas le choix de trouver ça intéressant et de vouloir t’engager.
[musique]
Louis Houle : Bienvenue aux Conversations pédagogiques avec des passionnés. Initiée par le Centre franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de retrouver Martin Laporte, un passionné de pédagogie, d’animation culturelle, d’improvisation et de construction identitaire, toujours à la recherche de nouvelles façons de faire vibrer la langue française.
Diplômé en commerce, Martin a commencé sa carrière comme animateur culturel à l’École catholique Béatrice-Desloges du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, dans la région d’Ottawa. Depuis plus de 20 ans, il œuvre au sein de ce même conseil où il est maintenant gestionnaire de projets en construction identitaire, organisant ainsi de multiples activités pour renforcer la fierté francophone. Retrouvons ensemble Martin Laporte.
[musique]
Quel bonheur aujourd’hui de me retrouver avec Martin Laporte pour parler pédagogie. Martin, merci d’être là aujourd’hui.
Martin : C’est un plaisir d’être avec toi, Louis.
Louis : On va commencer ça tout de suite. Je sais que tu es un passionné parce que je te suis sur les réseaux sociaux, je sais que tu fais partie d’Improtéine, je sais que tu travailles dans les écoles aussi à Ottawa et de toute sa région. Si je te pose comme première question aujourd’hui, parle-moi d’une de tes passions.
Martin : J’en ai quelques-unes des passions, mais évidemment, l’improvisation en fait partie. J’ai fait de l’impro depuis que j’étais en 8e année. Un enseignant qui m’a fait découvrir ça en salle de classe, ça a été un coup de foudre. J’ai réalisé que j’étais bon là-dedans, donc j’étais capable d’être drôle. Ça m’a suivi tout au long de mon secondaire, je fais de l’improvisation. J’en ai fait à l’université, puis, après ça, on a fondé le groupe Improtéine, on a fait des centaines de spectacles partout à travers le Canada.
Ça m’a vraiment permis, justement de découvrir cette francophonie hors Québec, qui est un peu aussi mon autre passion. La francophonie en milieu minoritaire, ça me passionne, ça vient me chercher en dedans. J’ai grandi là-dedans, j’ai toujours vécu cette dualité linguistique-là. De travailler à faire vivre l’effervescence francophone en milieu minoritaire, c’est passionnant.
Louis : Quand tu dis justement faire vivre, parce que je pense que ça fait partie de ton travail, j’aime beaucoup le mot que tu as utilisé, cette effervescence, j’irais plus loin dans ma question, mais je te demanderais, pourquoi est-ce que c’est important aujourd’hui de faire vivre le fait français? Pourquoi c’est important l’animation culturelle en Ontario?
Martin : Une culture, d’abord, il faut que ça se vive. On ne peut pas juste en entendre parler, il faut le vivre. C’est aussi la meilleure façon de développer un sentiment d’appartenance. L’objectif, c’est vraiment de faire vivre des expériences positives, en lien avec la francophonie en général, pour qu’autant les élèves que les adultes, que les communautés aient le goût de faire partie de cette communauté-là et de s’engager.
Louis : Est-ce que c’est difficile de faire ça?
Martin : Évidemment, ce n’est pas facile. Disons qu’on travaille évidemment à contre-courant, de plus en plus dans le sens que la culture américaine est tellement accessible, tellement financée et tellement populaire, mais ce qui rend la francophonie en Ontario, dans les écoles, en tout cas, qui la rend plus tangible, c’est le fait qu’elle est accessible. C’est là, c’est de vivre des expériences. Tout ce qui fait partie de la culture américaine, c’est des choses qui se consomment passivement, tandis que nous, dans les écoles, on essaye de le faire vivre en vrai, ce qui permet justement à l’élève de vivre des choses réelles, des choses authentiques. Ça, c’est ce qui fait la différence, vraiment.
Effectivement, ce n’est pas facile parce que de plus en plus, les élèves sont bilingues, les élèves ont un parent anglophone, un parent francophone, donc sont bilingues en arrivant à l’école. Là, c’est vraiment une question d’influencer l’élève à faire le choix de communiquer en français. On développe aussi la capacité des élèves à communiquer en français, autant oralement qu’à l’écrit, évidemment c’est le rôle de l’école, mais plus que ça, c’est qu’il faut semer afin que l’élève, plus tard, quand la maturité sera au rendez-vous, puisse faire le choix de continuer à vivre en français.
Louis : C’est drôle parce qu’au début de ta réponse tu as dit « accessible ». J’ai l’impression, là, il va falloir que tu me convainques parce que tu l’as dit, la culture américaine est omniprésente, c’est facile, on a juste à ouvrir nos réseaux sociaux, n’importe quoi, finalement. Quand tu dis « accessible », dans mon petit village, l’Est ontarien, il va falloir que tu me prouves ça que c’est accessible, parce que je n’ai pas l’impression que c’est si accessible que ça.
Martin : Peu importe le village ontarien dans lequel tu es, tu as quand même plus de chances de rencontrer Celeste Lévy que Taylor Swift. Pas que je compare les deux, mais c’est que les références sont accessibles. Qu’on parle d’artistes ou qu’on parle de célébrités franco-ontariennes, on parle de référent alimentaire, des curves de Saint-Albert, ça se vit, c’est un référent culturel très franco-ontarien. C’est ça qui rend ça accessible, c’est le fait que les gens sont proches, les gens sont issus du même milieu, donc les chanteurs franco-ontariens, les gens qu’on présente en spectacle dans les écoles, ils viennent du système, ils connaissent la réalité des élèves, des écoles, puis ils ont un lien en partant parce qu’ils ont à leur place. C’est ce qui fait que, quand je dis « accessible », c’est à ce niveau-là.
C’est aussi qu’en grande partie, la culture franco-ontarienne se vit à l’école, du moins 1/3 de la journée, donc ils sont dedans. Ils sont dans un environnement qui a comme mandat de justement faire vivre cette culture-là. On a le rôle d’être des passeurs culturels, donc de permettre à la prochaine génération de s’approprier les référents de la culture. Ça se passe là, ils ne sont pas obligés de faire un effort nécessairement pour le vivre.
Louis : À travers l’histoire, si l’on parle du début, en tout cas, le français en Ontario, est-ce qu’on a toujours été conscient de tout ça? Est-ce qu’il y a eu des événements qui ont fait en sorte que tout d’un coup, on a pris conscience qu’il faut en parler, il faut justement ce vecteur qui est l’école, on est dedans, il faut en prendre conscience, puis il faut l’utiliser? Ça a toujours été comme ça?
Martin : Ça n’a pas toujours été comme ça, mais je te dirais que chaque génération a eu ses combats, si on veut. On commence ça. On peut faire une ligne de temps qui date de la bataille avec les Anglais et les Français aux Plaines d’Abraham, mais on va sauter jusqu’en 1912 avec le Règlement 17. C’est vraiment la première prise de conscience que le français en Ontario n’est pas chose acquise, n’est pas chose respectée de tous. S’ensuit la bataille des épingles à chapeau, évidemment les manifestations pour sauver ce droit à l’éducation de langue française. Ça commence avec ça. Puis, de ça a découlé évidemment le droit quand le Règlement 17 a été aboli, donc on a eu le droit d’avoir des écoles de langue française.
Au niveau identitaire, à la fin des années 60, avec le mouvement nationaliste au Québec, il y a eu un peu la fin du terme Canadien français. Les Québécois, qui avant étaient pour la plupart des Canadiens français, sont devenus Québécois. Dans le sens que, là, il ne restait plus de place, notamment, le terme Canadien français ne s’appliquait pas, laissant les minorités linguistiques dans les autres provinces de se chercher une identité. C’est peut-être de la sémantique, mais il reste que c’est quand même un moment important de dire : « Si eux sont Québécois, qui l’on est, nous? »
Louis : Qui l’on est? C’est ça.
Martin : Puis, en 75, ça va faire 50 ans cette année, il y a eu la création du drapeau franco-ontarien. C’est vraiment le premier moment où c’est comme : « Ça, c’est notre symbole. On a quelque chose qui nous unit, qui nous représente et donc nous sommes Franco-Ontariens. » 75, c’est vraiment le début de la culture franco-ontarienne.
Louis : Un jalon important.
Martin : Un jalon important. Suite à ça, évidemment, la Charte canadienne des droits et libertés qui confère le droit de l’éducation dans la langue de la minorité, ça, ça a été vraiment important également. On se sert encore de tout ça dans les tribunaux aujourd’hui pour aller chercher des droits, pour revendiquer du financement, tout ça. L’affaire Mahé, en 90, par exemple, ça, ça l’a solidifié, ça a permis à la Cour suprême d’élaborer, d’aller plus loin que juste la charte et de dire : « Ça, ça vient avec des responsabilités. » Ça ne va pas faire plaisir à toutes les provinces qui, soudainement, avaient des responsabilités envers leurs minorités linguistiques, mais c’est quand même un jalon important. En 98, la création des conseils scolaires. Ça aussi, c’est vraiment un moment important. On avait gagné le droit de la gestion de nos conseils scolaires. Puis, en 2004, qui est la politique d’aménagement linguistique qui est peut-être plus passée dans le beurre. À l’époque, c’était important, mais ça a quand même un peu révolutionné dans le sens que ça a donné un mandat spécifique au réseau francophone d’éducation. Le mandat n’était plus seulement de transmettre des connaissances, d’éduquer les élèves, mais également d’assurer la pérennité de la communauté linguistique.
Louis : Là, c’était écrit.
Martin : Oui, c’est ça. C’était une politique du gouvernement qui, justement, donnait ce mandat extrêmement large au système scolaire de faire en sorte que les communautés restent vivantes. Il y avait tout un système d’engagement, de faire vivre la culture, justement, de là et ressortir les animateurs culturels. C’est avec ça que, dans pas mal de chaque école secondaire en Ontario, il y a de l’animation culturelle, ça découle de la politique d’aménagement linguistique. Il y en avait avant. En 94, on a développé le guide Investir en animation culturelle, qui, déjà, mettait en place des éléments importants dans une école de langue française où il fallait absolument que les élèves vivent des choses en français, qu’il y ait des radios étudiantes, des équipes d’impro, qu’il y ait des activités et que les élèves se regroupent pour vivre des moments de socialisation comme ça.
C’est un peu ça qui nous a amenés à aujourd’hui et c’est pour ça qu’à travers tout ce que l’école fait, il doit avoir ce mandat-là. Parce que, si l’on ne visite pas ce mandat-là, on n’a pas de raison d’exister. C’est un peu ça. Le lien avec le communautaire, de faire en sorte que les élèves puissent vivre des expériences francophones autant à l’école qu’à l’extérieur de l’école. Ça aussi, ça fait partie du mandat des conseils scolaires.
Louis : Là, on va aller un petit peu plus personnel. Toi, Martin, quand tu te retrouves devant des étudiants, ils ne te connaissent pas trop, admettons, si ça se peut, [rires] et qu’ils sont plus intéressés par leur cellulaire ou leurs amis, leur sport, ou quelque chose d’autre, qu’est-ce que tu fais pour rendre important, ou, en tout cas, pour donner une importance à ce qui se passe en français ou à tout ce qui s’appelle l’animation ou l’identité? C’est quoi que tu fais de toi?
Martin : Ça se fait sur le long terme aussi. Ce n’est pas quelque chose que soudainement, tu rencontres quelqu’un et tu dis : « Il faut que ça soit important pour toi. » Ce qui est important, c’est vraiment de permettre à l’élève de vivre un éventail d’expériences pour voir qu’est-ce que lui, il veut faire. Il ne peut pas savoir ce qu’il ne sait pas. S’il ne voit jamais un match d’impro, il ne peut pas savoir qu’il va aimer ça. C’est un peu dans cette optique-là, on doit vraiment proposer un éventail d’activités. En tout et partout aussi, il ne faut pas le forcer. Je pense que pour connaître les ados, j’en ai quelques-uns à la maison, si on leur dit : « Fais ceci », eux autres, ils entendent : « Okay, je vais tout faire sauf ça. » [rires] C’est un peu ma philosophie, moi, dans le fond, c’est que je vais faire vivre des affaires tellement fun que tu n’auras pas le choix de trouver ça intéressant puis de vouloir t’engager. Je vais te permettre d’avoir assez de plaisir que tu vas faire ce choix-là. Je ne veux pas l’enfoncer dans la gorge.
C’est un peu ça qu’on fait à travers nos activités. On fait aussi prendre conscience que si on a ces activités-là, c’est parce qu’on est francophones en Ontario et ça aussi, c’est une différence, c’est une attraction. Il y a énormément d’activités dans le système francophone. À l’intérieur des conseils, il y a plein d’événements qui sont organisés, mais aussi provincial. Ça aussi, c’est unique au système de langue française en Ontario.
On a des tournois d’impro provinciaux, on a un festival quand ça nous chante pour tous les groupes de musique, un festival de danse, un festival d’art visuel. On a vraiment beaucoup d’activités où les jeunes de partout en Ontario peuvent se regrouper pour socialiser en français, pour partager une passion commune en français. Ça, c’est vraiment des moments identitaires importants. On le voit parce que tous les gens qui reviennent dans le système francophone, que ce soit comme artiste, comme enseignant, comme partenaire communautaire, ils ont tous ça en commun d’avoir vécu quelque chose, une activité de la FESFO dans les années 1990, un festival, un tournoi d’impro, tout ça. Ils ont tous vécu ça.
Cette importance-là de permettre ces activités-là, ça fait en sorte que, justement, la communauté reste vivante parce que ces gens-là reviennent dans le réseau, puis ils deviennent engagés et ils font bouger les choses à leur façon. C’est un peu ça quand je parlais tantôt de semer à travers nos activités. C’est ça, puis, on les récolte juste plus tard. C’est ça qui est un peu plat quand on parle de construction identitaire, d’animation culturelle, c’est qu’on ne va pas nécessairement voir les fruits du travail automatiquement. Le nombre de fois où j’ai vu de jeunes enseignants arriver, c’était comme si c’était des élèves qui n’ont jamais dit un mot de français au secondaire. Puis là, ils enseignent le français, il y a eu quelque chose. Ça me démontre que j’ai assez fourni à cet élève-là–
Louis : Semé.
Martin : Oui, j’ai assez semé que la personne, quand le temps fut opportun, elle a eu cette réflexion-là, puis est revenue.
Louis : En même temps, dans ce que je comprends, c’est qu’on va fournir de la variété, donc plusieurs types différents, pour faire en sorte que– Peut-être que toi, tu n’aimes pas ça l’impro, mais peut-être que c’est la chanson, peut-être que c’est les concours oratoires ou je ne sais pas quoi, et cetera, qui vont faire en sorte qu’à un moment donné, tu vas briller en français. Ça va te rester pour plus tard, tu vas dire : « Je me souviens. » C’est comme tu dis : « On va semer beaucoup, puis en espérant qu’un jour, la récolte soit bonne. »
Martin : Exact, c’est un peu ce que j’appelle la trinité en animation culturelle, c’est l’éveil, l’identification, l’engagement. Ça, il y a plusieurs formes. Ça peut être la prise de conscience, ou la prise de position, puis, la prise en charge. Bref, les activités d’éveil, c’est tout ce qu’on fait découvrir à l’élève. Quand on fait venir des spectacles à l’école, quand les gens sont spectateurs de quelque chose, quand on leur fait vivre, par exemple, un podcast en salle de classe, des choses comme ça. C’est toutes des activités d’éveil où on permet à l’élève de voir : « Okay, ça, c’est possible. »
Ensuite, quand on parle d’identification, il faut aussi avoir des moments où l’élève peut aller un petit peu plus loin là-dedans. Faire de l’improvisation, c’est décider de participer à un groupe de musique à l’école, d’avoir cette seconde étape pour les élèves qui ont vécu un éveil, ils sont comme : « Ça, ça m’intéresse, je vais aller plus loin. »
Ensuite aussi, il faut avoir, c’est la partie la plus importante, la partie engagement. C’est là que toutes les activités provinciales arrivent. C’est une chose de voir de l’improvisation, c’est une chose d’en faire, mais c’est une autre chose de représenter ton école pendant trois jours à Sturgeon Falls pour faire de l’improvisation. Ça prend un peu ce spectre-là. Ce n’est pas linéaire. Dans le fond, c’est qu’en tout temps, devant toi, tu as des élèves qui sont en mode éveil, en mode identification, pas en mode engagement. C’est très fluide. Puis, dépendant de ce qu’on fait, par exemple, tout le monde peut être en éveil quand c’est quelque chose de nouveau, mais après ça, tu permets aux élèves– Quand les élèves, par exemple, du secondaire, vont animer des ateliers d’improvisation à l’élémentaire, par exemple, en même temps, on a des gens qui sont dans différents moments identitaires. C’est un peu ça que l’animation culturelle fait, c’est de jumeler tous ces éléments-là pour faire en sorte que l’élève puisse en arriver à l’engagement dans quelque chose au niveau de la francophonie.
Louis : Comment est-ce que Martin Laporte se nourrit, lui?
Martin : Ça, c’est une bonne question.
Louis : Parce que je pense vivement que si on veut faire vivre, si on veut semer, je vais utiliser ton verbe, il faut que, nous aussi, on soit capable de se nourrir.
Martin : Oui. J’ai quand même la chance d’avoir énormément de contacts là aussi. En montant des projets, en travaillant avec de nouveaux partenaires, c’est là où qu’on se nourrit. Dans le fond, quand on se met ensemble, on dit : « Cette année, je vais travailler avec DJ Pierre, par exemple. » Cela, c’est nourrissant aussi, c’est comme qu’on va développer quelque chose ensemble. C’est à travers ces projets-là, c’est d’aller chercher des partenaires communautaires, de voir comment on peut mousser ça plus loin. Au niveau professionnel, c’est vraiment comme ça que je me nourris. J’ai aussi la chance justement, en faisant partie du groupe Improtéine, d’avoir un réseau de contacts assez grand, ça, c’est le fun aussi. Il n’est pas canadien aussi ce réseau-là. De voir ce qui se passe dans d’autres provinces, comment eux jouent avec ce monde-là, d’assurer la survie de la communauté linguistique minoritaire. Ça aussi, c’est très ressourçant, il y a plein de congrès aussi, il y a plein d’activités provinciales aussi.
Quand on se rend compte, on a une formation en animation culturelle justement chaque année pour tous les animateurs culturels de la province. Quand on est parti, il y a quelques années, on s’est dit : « L’expertise de ce domaine-là, elle n’existe pas ailleurs. » Il n’y a personne qui va arriver, par exemple, du Québec pour nous dire expert à une animation culturelle en Ontario, c’est très spécifique. On s’est dit : « Il faut se réunir ensemble, il faut en parler, il faut développer nos compétences, partager nos pratiques réussies, partager nos défis, tout ça. » Ça aussi, c’est vraiment quelque chose qui permet de se ressourcer. Il y a des événements comme Contact ontarois où toute la communauté, des diffuseurs de spectacles, des artistes viennent ensemble, des moments de rencontre comme ça. C’est des opportunités qu’on a en Ontario français qu’on n’aurait pas nécessairement ailleurs.
[musique]
Pour réécouter la suite de ce balado ou encore pour découvrir les autres épisodes, visitez le site internet du centre franco sur institut, sur l’onglet formation. Vous pouvez aussi les retrouver sur Spotify et sur baladopedago.com, un site qui propose une riche sélection de balados éducatifs en français. Enfin, pour découvrir l’ensemble de nos nouveautés, inscrivez-vous à notre infolettre, consultez nos réseaux sociaux ou visitez le centrefranco.ca.
[musique]
2e partie du balado
Martin : Oui. Quand on regarde dans l’approche culturelle de l’enseignement, qui est un autre guide du ministère qui est sorti après la politique d’aménagement linguistique pour développer le comment on fait ça dans une école, comment on fait ça en tant qu’enseignant. Puis la première règle de base, tout ce que je dis au début, c’est créer un lien avec les élèves.
[musique]
Louis : Bienvenue aux conversations pédagogiques avec des passionnés. Initiée par le Centre franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. Dans la deuxième partie de ce balado, Martin illustre comment la créativité peut marquer l’imaginaire des élèves. Il souligne également l’importance des référents culturels franco-ontariens, et encourage chacun et chacune à développer sa propre construction identitaire. Toi, est-ce que tu es plus un défricheur, ou quelqu’un qui aime entretenir après que c’est créé?
Martin : C’est drôle, je fais souvent les deux. La raison que j’aime beaucoup travailler dans ce poste-là, c’est que si j’ai une idée, je la fais puis si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Toutes les idées peuvent être bonnes. C’est vraiment d’y aller avec cette créativité-là, puis de pouvoir aller au bout de nos idées. Ça, les élèves le remarquent aussi. Pour le fun, on avait une activité d’impro. On est parti sur un délire. On s’est dit parfait, les prix pour les équipes, ça va être des légumes. Ça va s’appeler la maraîchère.
On avait des jeux de mots de légumes partout. Exemple, pour la huitième place, l’équipe recevait un immense sac de choux de Bruxelles. Les élèves étaient fous. C’était comme la meilleure journée de leur vie. Ils nous en parlent encore 2 ans après, mais c’est ce genre d’idée-là que c’est justement ça a l’air banal, mais pour les élèves, ça a marqué leur imaginaire. C’était tellement absurde, c’était drôle. Les gens ont eu du fun et ça les a marqués.
Louis : Parce qu’effectivement, si je reçois comme prix des choux de Bruxelles, puis je n’en ai jamais mangé de ma vie, ça devrait être intéressant comme [diaphonie].
Martin : Il y en a qui ont fait le saut, ça, c’est garanti. Ils ne s’attendaient pas à ce que– C’est cru un chou de Bruxelles.
Louis : C’est cru, un petit peu amer.
Martin : Ce n’est pas tant accessible ça.
Louis : Un petit peu de sirop d’érable au four, c’est encore meilleur. Je trouve ça très intéressant parce que je sens ta passion, puis je sens ton désir, en tout cas cette créativité-là qui ressort chez vous. Qu’est-ce que tu dis quand tu te retrouves devant des profs qui sont peut-être subjugués par la quintessence du moment présent? Dans le sens que tellement de choses qui se passent, qu’ils n’ont pas de temps. C’est tough à être prof. Qu’est-ce que tu leur dis? Comment tu les accompagnes?
Martin : Il y a plusieurs façons de le faire en tant que prof. C’est important de toujours utiliser des référents culturels dans son enseignement. Qu’on puisse faire des liens, construire le sens des choses. D’utiliser des référents culturels franco-ontariens, c’est un point de départ. On encourage beaucoup les enseignants à développer leur propre construction identitaire, découvrir des référents culturels. C’est sûr que tu as le droit de ne pas aimer ça, écouter de la musique en français ou de la radio en français. Tu as le droit. Il n’y a pas de problème. Je n’irai pas dans ta vie personnelle. Cependant, quand on travaille pour un réseau d’éducation de langue française, veut, ne veut pas, on a un petit peu le mandat d’être passeur culturel, qu’on le veuille ou pas.
L’argument, c’est aussi que, si personne ne le fait-
Louis : Qui le fera?
Martin : -il n’y aura pas de prochaine génération qui vont inscrire leurs enfants à l’école. Il faut que l’élève vive une expérience francophone assez positive pour que dans 10 ans, il se dise : « Moi, mes enfants, je vais les inscrire dans ce système-là. » À travers la PAL, une des choses qui sont dans la PAL, c’est les attentes génériques, qui venaient avec le mandat. Il y a deux attentes génériques que je ne connais malheureusement pas par cœur, mais, en gros, qui disent que, dans le fond, ton enseignement doit permettre à l’élève de pouvoir parler de référents culturels et pouvoir le faire en français. En gros, si je paraphrase, c’est ça.
S’il n’y a pas de communication orale dans ta salle de classe, il faut qu’il y en ait à un moment donné. Il faut qu’il y ait des référents culturels. Il faut que tu participes activement aux activités de l’école. Souvent, c’est une question d’attitude aussi. Comme je dis, des fois, parce que les enseignants, comme tu dis, ce n’est pas facile, mais le strict minimum, c’est au moins de ne pas nuire à ceux qui font avancer la francophonie. On a un spectacle à l’école.
Si toi, tu décides que tu ne fais pas la préparation de base, il n’y a aucune chance que les 30 élèves devant toi vivent une expérience positive. Le strict minimum, c’est d’au moins appuyer ce que les plus passionnés font, mais à l’intérieur de sa salle de classe, c’est vraiment de se poser la question comment est-ce que je fais pour qu’à travers différents cours que j’enseigne, que les élèves vivent une expérience positive en français, puis qu’ils développent des référents culturels liés à la francophonie?
Louis : Parce que tantôt tu parlais de la trinité, mais j’imagine que ça s’applique aux profs aussi ça.
Martin : Oui, absolument. Ça s’applique à tous les adultes aussi. Comme il y a des enseignants quand on fait, des fois, des– on montre d’autres façons de faire de la communication orale. Soit d’évaluer de la communication orale ou de proposer autre chose que la présentation orale classique. Un élève tout seul, en avant de la classe qui n’a pas de plaisir pendant que 29 personnes ne l’écoutent pas parce que ça ne les intéresse pas. Comme je pourrais dire dans la hiérarchie des moments positifs, c’est assez bas. C’est que, si on ne leur présente pas d’autres façons, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils en développent eux-mêmes. À travers les formations, on a des équipes sur le terrain qui aident aussi, qui peuvent appuyer.
Il y en a beaucoup de profs qui ont découvert le podcast, qui est très à la mode. On a développé une formation pour outiller les enseignants à faire faire des podcasts aux élèves. Soudainement, la communication orale était beaucoup plus intéressante. C’était moins long parce qu’il y avait plusieurs élèves qui pouvaient le faire en même temps. Ce n’était pas plat, c’était actif. Les jeunes ne sont pas passifs là-dedans. Ça a été un éveil pour beaucoup d’enseignants qui à ce temps sont autosuffisants là-dedans. Il y a beaucoup d’évaluations qui sont faites. Ça peut être fait en maths. On peut faire des podcasts sur n’importe quoi. C’est un exemple parmi tant d’autres, mais oui, les enseignants sont en éveil.
On partage des listes de lecture à jour aux enseignants aussi parce qu’eux aussi doivent développer ça. C’est des modèles. Les élèves, dépendant de l’âge, ils sont tous des modèles. Des fois, les ados le démontrent un petit peu moins, mais à l’élémentaire, c’est des modèles. Si un enseignant arrive et dit : « Hier soir, j’ai écouté telle émission en français. J’adore ça, c’est vraiment bon. » Les élèves vont être intéressés à écouter ça. C’est important pour que les enseignants prennent conscience de ça. J’ai une influence sur ce que les élèves vont arriver.
Si chaque fois que j’arrive puis c’est comme voici l’activité que j’ai faite en anglais, les élèves vont être intéressés à ça. C’est correct, il n’y a pas de problème. Il faut qu’il y ait aussi des choses en français au répertoire de ce que tu présentes aux élèves. Quand les enseignants prennent conscience de : « Okay, j’ai vraiment une influence sur ce que les élèves vont écouter ou ce que les élèves vont faire », à ce moment-là, c’est plus simple d’intéresser au moins à quelque chose, un référent culturel francophone.
Louis : Là, tu as parlé de référent. Au moins les mentionner, puis d’en être conscient, puis de ne pas nuire. Moi, si je suis un prof qui commence– Je pose toujours cette question-là parce que je trouve que c’est vraiment un défi. Où est-ce que je navigue entre mon curriculum que j’étais en train d’apprendre, mais la gestion de classe, puis mes stratégies pédagogiques, puis là, moi je brûle parce que j’ai entendu ce que tu as dit. Moi, j’ai vécu plein de choses au secondaire aussi. Quel conseil tu donnerais? Oui, tu as parlé de référent, mais du concret. Je devrais faire quoi dans mon prochain mois avec mes élèves?
Martin : Quand on regarde dans l’approche culturelle de l’enseignement, qui est un autre guide du ministère qui est sorti après la politique d’aménagement linguistique pour justement développer le comment on fait ça dans une école, comment on fait ça en tant qu’enseignant. La première règle de base, tout ce que je dis au début, c’est créer un lien avec les élèves et ça, c’est vraiment la partie la plus importante. Beaucoup d’enseignants– Je ne les blâme pas. Enseignants en 2025, c’est énorme la quantité de travail qu’on leur demande, donc, évidemment, ceux qui commencent, on veut qu’ils survivent pour qu’ils restent dans le système, on a besoin d’eux.
Louis : Parce qu’il y a un pourcentage qui, après 3 ans, abandonne.
Martin : Exact, mais je pense que la règle de base, c’est créer un lien avec tes élèves, prendre le temps au début de développer cette connexion-là, apprendre à les connaître, prendre le temps au début pour aller plus loin et plus vite par la fin. Des fois, on se dit parfois : « Après 2 semaines, je devrais être rendu là. ». Il ne faut pas se donner cette base-là parce que là, on va être stressé tout le long. Je vais prendre un temps, apprendre à connaître, on va faire des activités brise-glace, on va apprendre par le jeu, on va développer cette dynamique de groupe qui fait partie de la culture aussi.
La dynamique d’un groupe, c’est très culturel, puis c’est représentatif aussi de l’Ontario français, donc de prendre ce temps-là et après, les élèves vont embarquer beaucoup plus facilement dans ce qui s’en vient. De mettre l’élève au centre aussi. Ça a été très populaire, la coconstruction de critères, des choses comme ça, mais d’offrir des choix. Il n’y a rien qui dit que l’évaluation doit être faite de cette façon-là, que tel projet doit être exactement ça. D’offrir des choix, mais comme je dis, la base, c’est vraiment de créer une dynamique de groupe, parce que quand tu crées ton lien, quand tu sais que tel élève, c’est un passionné de hockey, ta porte d’entrée est là, puis tu peux aller chercher l’élève par la suite.
Ta gestion de classe va se faire beaucoup plus facilement si tu as pris le temps de créer ce lien-là, si tu as pris le temps d’expliquer aux élèves pourquoi c’est important pour toi la francophonie, pourquoi c’est important qu’il y ait une communauté francophone, de prendre du temps pour expliquer ça, les élèves vont beaucoup plus embarquer dans la classe, dans les projets, dans les curriculums.
Louis : Je suis complètement d’accord avec toi parce que ma première année comme enseignant, j’avais 16 élèves, un groupe extraordinaire, classe simple et ne me demande pas pourquoi je n’étais pas conscient qu’il fallait développer ce lien avec les élèves. Ç’a été la pire année de ma vie comme prof. J’avais une direction d’école super gentille qui disait : « Louis, crées-tu des liens avec tes élèves? », et cetera. Quand je l’ai compris, il y a eu comme un déclencheur extraordinaire qui a fait en sorte : « Moi, je suis ici pour un bout parce que là, ça fonctionne. »
Je suis complètement d’accord avec toi quand tu dis créer le lien, puis après ça– Oui, ça prend du temps, comme tu as dit, mais tu vas en gagner après justement. Là, justement, le temps avance, mais, moi, la question, aujourd’hui, si tu avais un monde idéal et que tu pouvais faire ce que tu voulais, parce que– Dans le cadre actuel, on te laisse lousse, on dit : « Go, Martin! », qu’est-ce que tu ferais?
Martin : Ça, c’est la question à 100 pièces, mais, moi, c’est qu’il y aurait quelqu’un dans chacune des écoles, un membre du personnel que son travail, c’est justement d’assurer, de mettre des référents culturels partout dans les curriculums, de s’assurer que tout ce que les élèves vivent à l’école, c’est positif, qu’il n’y ait plus rien de plat. Que les évaluations soient le fun, qu’on trouve une façon d’évaluer la réussite de l’élève, puis que ce ne soit pas plat. Si l’élève a du fun 6 heures par jour à l’école, la bataille va être gagnée parce qu’il va avoir créé ce lien-là. Mon souhait ultime, c’est que ce ne soit pas juste le fun dans les activités que les animateurs culturels font, mais que ce soit le fun tout le temps.
C’est un vœu pieux, mais je pense que c’est vers ça qu’on s’enligne quand on travaille, quand on essaie d’amener les activités à l’intérieur, de créer des liens pédagogiques avec les activités, donc c’est ça qu’on veut faire. Je vais donner un exemple, beaucoup de conseils font ce qu’ils appellent une folie furieuse. On développe des fiches d’artistes, on propose une vingtaine de chansons que les élèves étudient de différentes façons à travers des activités pédagogiques, des activités ludiques aussi, puis ça culmine à une grosse journée de festivités, un quiz entre écoles. Ils se réunissent les 5-600 élèves, il y a une partie spectacle avec des artistes qui ont étudié.
Ça, c’est un exemple où justement l’animation culturelle se vit parce qu’on le fait en salle de classe, on crée des activités d’évaluation en lien avec des référents culturels puis, après ça, les élèves vivent en personne, donc ça construit le sens. On a des connaissances, puis on comprend pourquoi on a appris ça, qu’on a découvert ces gens-là, puis c’est à un moment tout à fait extraordinaire. On fait souvent des artistes de la relève franco-ontarienne aussi là-dedans. Ça fait que l’artiste vient chanter sa chanson, puis il y a 600 jeunes qui la chantent à tue-tête et souvent, les artistes franco-ontariens n’ont pas ce luxe-là d’arriver dans une salle de spectacle où il y a 500 personnes qui chantent leurs chansons.
Ça crée un moment identitaire très fort. Nous, on vise les cinquièmes années, mais on le voit quand ils arrivent au secondaire, ces élèves-là connaissent ces artistes et ils sont déjà un petit peu plus engagés. Ils ont réussi à voir qu’à travers tout ce qu’on leur a proposé, la musique en français, ce n’est pas un style de musique. Il y a des choses que je peux apprécier en français, c’est correct de ne pas tout aimer, mais je comprends qu’il y a plusieurs éléments. Ça, c’est vraiment un déclic qui est important quand on découvre que, justement, exemple la télé en français, ce n’est pas un style de télé. Ça, c’est vraiment important aussi comme message. Mon vœu, c’est que tout soit fait de façon fun.
Louis : Signifiant et le fun. Justement, tu as parlé d’intention pédagogique parce que quand tu étudies tes chansons, tu as une intention pédagogique puis après ça tu vas le vivre. Je trouve l’exemple excellent.
Martin : Oui, c’est ça. Les activités d’animation culturelle, ce n’est jamais vide de sens, c’est pour ça qu’on dit souvent l’animation culturelle, ce n’est pas juste de faire des activités, ce n’est pas juste de faire des […], tout ça, il y a un sens à construire ça. Il y a une stratégie, c’est réfléchi. C’est pour ça qu’en Ontario on a développé des professionnels en animation culturelle, parce que ce n’est pas juste des animateurs de camps d’été, on a besoin des animateurs de camps d’été, mais c’est réfléchi cette approche.
Louis : Là, si je te demandais, est-ce qu’il y a une ressource que tout le monde devrait connaître pour nous aider dans notre travail?
Martin : Oui, il y en a plusieurs. C’est sûr que la politique d’aménagement linguistique, apprenez-là par cœur, c’est vraiment pertinent, mais, à travers le réseau des leaders en animation culturelle provinciale, on a développé le site animationculturelle.com, c’est facile à retenir. Si l’on parle d’animation culturelle, on ajoute un point com, et nous voilà rendus. C’est là qu’on va vraiment trouver tout ce qui se passe en animation culturelle en Ontario, on a beaucoup de ressources sur, justement, c’est quoi de l’animation culturelle, comment en faire, toutes les activités provinciales qui sont accessibles à tout le monde.
Il y a plein de liens vers des ressources de partenaires aussi parce que ce lien-là avec la communauté, de voir que le français, ce n’est pas nécessairement juste à l’intérieur de l’école, ça aussi, c’est important. Tout ça est disponible sur le site animationculturelle.com. C’est un site vivant. Vous avez aussi accès aux ressources qui ont été développées lors des formations provinciales des animateurs culturels, même hors contexte. Des fois, ça ne dit pas grand-chose, mais ça peut être très pertinent quand même de voir ce qui a été développé ou des idées de comment ajouter des référents culturels à son enseignement, tout ça a été discuté, puis c’est disponible sur animationculturelle.com.
Louis : Là, dans notre balado, on arrive au moment où je vais te dire un mot et je te propose que tu dises deux phrases; par exemple, si je te dis le mot aujourd’hui.
Martin : Moi, je dirais qu’aujourd’hui, c’est le meilleur moment pour commencer à faire de l’animation culturelle avec ses élèves.
Louis : Okay. Prochain mot : curriculum.
Martin : En deux phrases, je dirais que c’est important, mais moins important qu’on pense. Tout le monde va survivre si l’on n’a pas couvert à 100 % le curriculum. Il faut juste se rappeler ça.
Louis : Prochain mot, c’est deux mots, c’est : « Oui, mais… ».
Martin : Moi, je dirais, comme on dit en improvisation, on ne devrait jamais dire « Oui, mais… », on devrait dire « Oui, et… ». C’est déjà difficile d’avoir des idées, ne soyons pas des gens qui viennent mettre des bâtons dans les roues, soyons ceux qui ajoutent aux idées.
Louis : En même temps, encore deux mots avec trois petits points, « Oui, mais comme toujours… ».
Martin : Ce n’est pas parce qu’on ne l’a jamais fait que ça ne marchera pas. Ce n’est pas parce qu’on l’a toujours fait que c’est la bonne chose à faire.
Louis : Puis, dernier, un mot que tu aurais aimé que j’ajoute à cette liste pour que tu puisses commenter?
Martin : J’aurais mis– Comment je pourrais dire ça? C’est le mot engagement. Je pense que je l’aurais ajouté à la liste parce que c’est la base de tout. Si l’on permet aux gens de s’engager dans ce qui les passionne, on va automatiquement ouvrir beaucoup de portes pour les élèves.
Louis : Parfait. Excellent. Merci. Moi, j’ajoute une autre question qui n’était pas dans ma liste. Quand tu parles d’engagement, ce n’est pas finalement comme donner une voix à ces élèves-là?
Martin : C’est beaucoup donner la voix à des élèves. La voix des élèves, c’est ce qui est important, c’est ce qui va nous permettre de s’assurer que les élèves ont accès à des activités ou des expériences qu’ils veulent développer. La voix des élèves devrait être au centre un peu de tout. Il y a beaucoup de conseils scolaires, justement, qui ont, par exemple, des élèves conseillers qui vont être un peu la voix des élèves, s’assurer que les adultes dans la pièce n’oublient pas pour qui on fait ça. Le curriculum n’a pas été développé par des élèves, mais peut-être que le comment on va développer ces connaissances-là, ça, ça peut peut-être être fait par des élèves.
À travers tout le système, il y a des élèves qui demandent juste d’être écoutés, d’avoir des occasions de partager leurs idées, de discuter de l’éducation. Puis, en tant que conseil, on a le mandat d’écouter ça. Ce n’est pas parce qu’ils sont jeunes qu’ils ne sont pas pertinents. Au contraire, je pense qu’ils en ont très long à dire sur ce qu’ils vivent au quotidien. Puis, des fois, on peut être au siège social, penser à de bonnes idées, mais sur le terrain, c’est important de savoir comment c’est vécu, comment on peut le changer et comment ça peut être mieux. C’est les élèves qui doivent être au centre de ça.
Louis : Martin, on arrive déjà à la conclusion. Moi, j’aurais continué cette discussion avec toi parce que je trouve qu’aujourd’hui– Je vais arrêter parce qu’habituellement je dis qu’on arrive à la conclusion, puis je fais une conclusion, mais là, je ne veux pas parce que je veux te donner la chance justement de conclure. Tu peux le faire comme tu veux. De conclure ce balado aujourd’hui. Question précise : Martin, est-ce que tu pourrais conclure, s’il te plaît, cette discussion, ce balado en conclusion aujourd’hui ?
Martin : En conclusion, j’espère que les gens qui écoutent, qui sont nombreux, par milliers, je pense-
Louis : Oui.
Martin : -comprennent qu’ils ont un rôle névralgique dans la survie de la francophonie en Ontario. Que tu le veuilles ou pas, si tu es dans notre système, tu es important, tu es un modèle. D’être conscient de tout ça, c’est vraiment la première étape de grandes choses et d’une grande évolution. Soyez conscient de l’importance que vous avez. Vous êtes une pièce importante de ce casse-tête qui est la survie linguistique des francophones en Ontario.
Louis : Il ne me reste qu’à te remercier, Martin pour cette conversation aujourd’hui. Je tiens à rappeler à tout le monde que Martin est gestionnaire de projets en construction identitaire pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Martin Laporte, merci beaucoup.
Martin : Tout le plaisir était pour moi.
[musique]
Louis : Pour écouter la suite de ce balado ou encore pour découvrir les autres épisodes, visitez le site Internet du Centre franco, sur Instituts, sur l’onglet Formations. Vous pouvez aussi les retrouver sur Spotify et sur baladopedago.com, un site qui propose une riche sélection de balados éducatifs en français. Enfin, pour découvrir l’ensemble de nos nouveautés, inscrivez-vous à notre infolettre, consultez nos réseaux sociaux ou visitez lecentrefranco.ca.