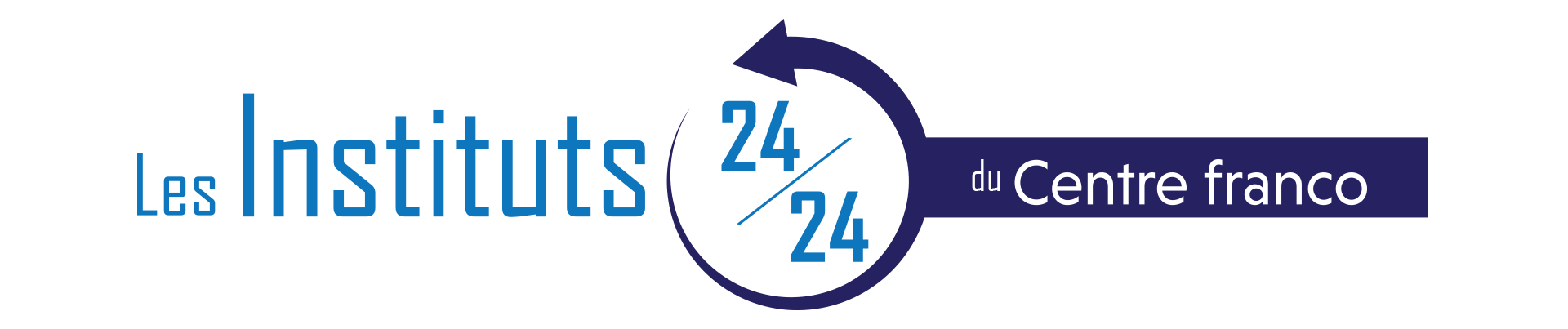À la rencontre de Serge Dupuis – L’histoire éclaire le présent et inspire l’avenir!
Épisode 11
Né à Sudbury, en Ontario, Serge Dupuis est un historien professionnel travaillant à Québec. Il est membre associé à la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN) de l’Université Laval.
Serge Dupuis est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Laurentienne (2007), d’une maîtrise de l’Université d’Ottawa (2009) et d’un doctorat de l’Université de Waterloo (2013). Puis, il a terminé un stage postdoctoral en 2016 (Université Laval). Il a aussi obtenu des bourses du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour ses trois formations d’études supérieures.
Le Centre franco est sur Spotify!
Écoutez le balado de Serge Dupuis en cliquant sur la première partie et/ou la deuxième partie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode!
1re partie du balado
Serge Dupuis : On ne fait pas de l’histoire, à mon avis, pour faire de la restauration, pour retourner à une époque révolue. Au contraire, l’histoire est par rapport à l’avenir, par rapport à ce qu’on a envie de transmettre, d’inculquer et de bâtir pour l’avenir.
[musique]
Louis : Bienvenue aux conversations pédagogiques avec des passionnés. Initiée par le Centre franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. Aujourd’hui, j’ai le bonheur de parler avec Serge Dupuis. Ancien élève du Collège Notre-Dame dans le nord de l’Ontario, Serge obtient son baccalauréat à l’Université Laurentienne à Sudbury.
Ensuite, il fait sa maîtrise à l’Université d’Ottawa et termine son doctorat à l’Université de Waterloo en Ontario. Un stage postdoctoral l’amène à l’Université Laval pour travailler avec l’historien Martin Pâquet. Aujourd’hui, Serge fait de la recherche et on retrouve entre autres ses écrits en histoire politique de la francophonie ontarienne et canadienne. Transportons-nous ensemble chez lui où il sera question d’histoire et de pédagogie.
[musique]
Bonjour, je suis en compagnie aujourd’hui de Serge Dupuis, historien, membre associé de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord de l’Université Laval. Comme première question, Serge, j’aimerais que tu me parles d’une de tes passions.
Serge : J’aime beaucoup voyager, puis me déplacer, voir des environnements différents. Ça peut expliquer pourquoi je m’intéresse à l’histoire. C’est-à-dire, c’est un peu comme voyager dans le temps, aller visiter le contexte qui nous a bâtis, puis comment les choses se passent aujourd’hui. J’aime aussi me déplacer dans le monde réel, c’est-à-dire voyager. J’avais plus le temps de le faire avant que j’aie des enfants, puis que je travaille à temps plein, mais on en fait un petit peu beaucoup au Québec et en Ontario quand on peut.
Ce désir de me déplacer, de voir des environnements, de profiter du plein air m’amène à faire de la course à pied. J’essaie d’en faire un peu tous les jours pour me ressourcer, réfléchir puis faire battre le petit cœur.
Louis : On va bien s’entendre, parce que moi aussi, j’ai fait de la course dans ma vie. Quand on fait de la course, on dit que le temps, c’est important. On va aller dans cette direction. On va parler du temps, parce qu’on dit que le temps, c’est la quatrième dimension. Qu’est-ce que ça veut dire pour un historien comme toi?
Serge : C’est la dimension qu’on voit peu ou pas, le passage du temps, et pourtant, c’est bien réel, même si c’est pratiquement invisible. Parce que c’est une dimension qui a formé les trois dimensions qu’on voit actuellement. On peut s’en tenir à ces trois dimensions-là, sauf qu’il y a du passif, il y a des éléments qu’on peut difficilement prendre en compte si on ne les voit pas, puis on ne les comprend pas. Ça peut avoir un sens au niveau humain, social, politique. Il faut comprendre le passé pour comprendre le présent et l’avenir. C’est un truisme, mais moi, j’y crois beaucoup.
On ne fait pas de l’histoire, à mon avis, pour faire de la restauration, pour retourner à une époque révolue. Au contraire, l’histoire est par rapport à l’avenir, par rapport à ce qu’on a envie de transmettre, d’inculquer et de bâtir pour l’avenir. Si on veut imaginer l’avenir en connaissance de cause, ça veut dire qu’il faut s’intéresser au passé. Ce n’est jamais passé, ça fait toujours partie du présent, mais on peut y jeter un nouvel éclairage. On peut aussi découvrir des choses qu’on comprend peu ou pas.
On m’a déjà demandé : « Est-ce que l’histoire, on ne la connaît pas déjà, de toute façon? » Je vous dirais, dans un cas comme l’histoire des Franco-Ontariens, la plupart des gens ne la connaissent pratiquement pas, au-delà d’un petit moment–
Louis : Charnière?
Serge : C’est ça. Ça pose problème aussi pour la pérennité de cette petite société-là. Qu’on connaisse aussi peu son histoire, c’est un risque parce que ça nous empêche, ça nous prive de bâtir l’avenir sur des assises solides si on ne connaît pas ce passé-là. Il y a les institutions qui sont en place, mais leur pérennité est fragile si on n’est pas capable de justement leur inculquer un sens et un destin.
Louis : Je trouve ça très intéressant quand tu dis que l’histoire, ce n’est jamais passé, ça fait partie du présent. Je n’avais jamais vu ça comme ça, mais pour un élève, pour un jeune de quatrième année, moi, si je suis prof, comment je fais pour intéresser mes jeunes à l’histoire?
Serge : J’ai l’impression, du moins dans mon expérience personnelle, parce que j’étais un de ces élèves-là au primaire, Franco-Ontarien, dans les années 90, personnellement, j’ai pris la piqûre de l’histoire par la généalogie. On organisait des rencontres familiales des Dupuis, puis l’idée avait été évoquée de faire un arbre généalogique. On n’avait pas des instruments numériques à l’époque, il fallait faire des recherches dans les bases de données papier, dans les registres papier qu’on avait. J’ai trouvé ça intéressant. C’étaient des noms et des dates, des fratries, des déplacements. Chaque individu avait une histoire intéressante, peu ou pas connue.
C’est là que je me suis dit : « Ça pourrait être très intéressant d’étudier ça. » Effectivement, à l’université, j’ai poursuivi des études en histoire, toutes sortes d’histoires : l’histoire de l’Occident, histoire des problèmes contemporains, des États-Unis, du Canada dans le sens large. L’histoire des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariens du Nord m’a interpellé parce que c’était un peu notre histoire, à nous, qui était racontée par la mémoire des anciens.
J’ai connu une arrière-grand-mère. J’ai aussi connu trois de mes grands-parents qui ont pu me parler de leurs histoires familiales. De cette manière, le Règlement 17 a été vécu, du moins par cette arrière-grand-mère que j’ai connue. C’est en train de disparaître, ces liens-là. Il n’y a plus de gens autour de chez nous qui ont vécu le Règlement 17, mais ma grand-mère qui est encore des nôtres a été scolarisée tout de suite après le Règlement 17.
En connaissant ces histoires-là, j’ai pu poser des questions aux anciens et j’ai commencé à enregistrer des histoires de ma grand-mère. Ça fait pour une conversation très intéressante qui nous permet de les comprendre, mais aussi de documenter une histoire qui existe peu ou pas. Le crochet de l’histoire familiale peut être intéressant parce qu’on a le contexte, mais on n’a pas le parcours individuel.
L’une des raisons pour lesquelles, par exemple, les romans historiques fonctionnent très bien, c’est parce qu’on utilise les outils de la littérature pour faire vivre des personnages. On se rend compte que ces gens-là ont été confrontés à des réalités souvent semblables, à des dilemmes semblables. Ils étaient des humains, eux aussi, qui ont cheminé, étaient confrontés à de l’adversité, et on cherchait à surmonter ces difficultés-là.
On n’est pas seul dans le présent, on a le vécu, la sagesse de ces gens-là qui nous ont précédés, et c’est là-dessus qu’on devrait pouvoir bâtir et perfectionner, d’une certaine façon. On n’a pas besoin de tout réinventer à chaque génération. On peut s’inspirer de ces exemples-là dans le passé, non pas pour les imiter à la lettre, mais pour s’en inspirer et trouver nos propres réponses aux dilemmes et aux défis auxquels on est confronté de nos jours.
J’ai l’impression que la partie de l’histoire locale, de l’histoire familiale, peut donner un sens à cette grande histoire-là qu’on essaie de transmettre aux jeunes. D’autant plus que les outils sont à portée de main aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas quand j’étais à l’école, dans les années 90.
Louis : Oui. Dans un contexte où nos élèves viennent d’un peu partout dans le monde, est-ce que ces outils-là, que tu parles, justement, font en sorte qu’on peut– Parce que là, finalement, ce que tu dis, c’est que si on part de nos racines, de nos familles, ça peut être un élément qui va faire en sorte que l’élève soit intéressé à l’histoire. C’est ça que tu dis?
Serge : Oui.
Louis : Ces outils-là permettent, que je vienne, je ne sais pas moi, du Tchad, de Russie ou d’Europe, de faire la même chose?
Serge : Je pense, oui, de deux manières. Moi, j’utilise très souvent deux bases de données importantes, c’est-à-dire les sources généalogiques et les journaux en ligne. Ancestry, c’est une des bases de données de généalogie. C’est sans doute la plus importante au monde. Ce n’est pas la seule, mais ça en est une importante. On peut acheter la version mondiale pour avoir accès à des registres dans d’autres pays.
Juste pour le Canada, ça peut être intéressant en soi parce qu’on a des recensements qui remontent au milieu du 19 ᵉ siècle, qui permettent de retracer l’arrivée, les déplacements, l’installation et l’évolution des familles, des individus et des communautés. Ce qui veut dire, par exemple, si on est des Franco-Ontariens de quatrième ou cinquième ou septième génération, on peut retracer l’histoire de la généalogie familiale de cette manière-là. Si on est originaire de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, ou d’Haïti, on peut avoir accès à des données généalogiques.
Les pistes ne fournissent pas toujours toutes les réponses. On ne trouve pas d’habitude, pour qui que ce soit, un registre parfait de traces complètes pour remonter. Il y a des informations qui ont été mal classées, il y a des ruptures. Dans ma généalogie, j’avais un grand-père irlandais. L’Irlande, qui a vécu six révolutions avant son indépendance, en a perdu beaucoup de registres. Ça peut être très difficile de faire l’histoire des Irlandais, par exemple, avant leur arrivée au Canada. Je pense que ça peut être la même chose aussi pour des gens dont les ancêtres sont venus de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, ou d’Haïti.
Ce qui est possible, cela étant dit, c’est de retracer les origines de ces communautés-là en Ontario. Il y a des projets, je pense, très intéressants à faire pour retracer l’histoire d’organisations, de familles, de communautés issues de la diversité à Toronto, à Ottawa, mais ailleurs aussi. Il y a des histoires dans le nord aussi à raconter sur les origines métisses de certaines familles.
On parlait beaucoup l’an dernier de la nomination de Michelle O’Bonsawin comme première juge autochtone au pays. Elle, dans son cas, ce sont des Franco-Ontariens, mais qui avaient des ancêtres abénaquis, qui ont participé aux migrations industrielles, qui ont attiré des gens du Québec et des Premières Nations vers les mines de Sudbury. Il y a une histoire très intéressante à faire, je pense, sur les Abénaquis en Ontario français, mais c’est une histoire qui n’a pas été écrite encore.
Les sources généalogiques peuvent nous permettre de retracer tout ça, principalement les recensements fédéraux, les recensements qui sont aux 10 ans. Aujourd’hui, c’est aux 5 ans, mais pendant très longtemps, c’était aux 10 ans. On peut remonter à 1931, 1921, 1911, puis contrairement à aujourd’hui, on a juste les mégadonnées. De 1931, en montant par en arrière, on a les informations complètes des familles. C’est-à-dire, on peut voir le revenu qu’ils gagnaient, l’instruction de chacun, l’occupation de chacun. On peut retracer l’histoire d’une famille de cette façon-là. Ensuite, on peut complémenter, on peut croiser ces sources-là avec les journaux dans lesquels on peut faire des recherches par mots-clés.
Heureusement, on a Le Droit et L’Ami du peuple pour le nord de l’Ontario et on a Le Droit pour l’Est ontarien. Il n’y a pas de journal océrisé encore pour le sud de l’Ontario, c’est un dossier sur lequel je travaille, mais on a accès à certains journaux aussi qui peuvent nous permettre de compléter ces informations-là, qu’on fasse de la recherche sur un individu, une institution, une localité ou un groupe particulier. Il ne faut pas oublier que d’ailleurs, Le Droit était un journal provincial à une époque. Ça a déjà été un quotidien qui offrait une grande couverture du nord et du sud de l’Ontario, même si aujourd’hui, sa couverture est principalement concentrée autour d’Ottawa et de Gatineau.
Louis : Parce que là, on dit, oui, on peut faire des recherches sur nos ancêtres, et cetera, mais en plus de ça, est-ce que tu peux nous parler d’autres stratégies qui pourraient faire en sorte qu’on pourrait inviter l’histoire chez nos élèves? Je prends comme exemple ma famille à moi. J’ai trois enfants et les trois enfants sont adoptés, dont deux de pays différents. Ça serait tout un défi chez nous si on faisait– La partie des parents, c’est facile, mais si eux autres voulaient faire une recherche par rapport à leurs parents biologiques, là, ce serait un grand défi, je pense. Est-ce qu’il y a d’autres stratégies que tu pourrais– À part de ça?
Serge : Il y a des sources internationales. Par exemple, en France, on est mieux organisé, au niveau de la disponibilité des journaux et des archives généalogiques, qu’au Canada. On a des archives radiophoniques aussi dans lesquelles on peut faire des recherches. Même à partir de l’Amérique du Nord, on peut accéder à plusieurs sources historiques en ligne, notamment par rapport à l’Afrique occidentale française, par exemple, à l’époque où c’était une partie de l’empire colonial français.
On peut aussi s’intéresser, de la bonne vieille manière, aux archives locales d’une petite organisation. Ça se fait. Souvent, les archives sont conservées, mais elles n’ont pas été traitées. Ça, ça peut donner des projets qui sont intéressants si on veut innover, si on veut traiter de certaines origines ou certaines communautés dans son milieu. Il y a des manières d’aller voir, de s’intéresser à ces organisations-là, ou de s’intéresser à son école ou à un quartier. Il y a de l’histoire partout. Il faut voir de quelle manière on peut accrocher un jeune à un aspect de son vécu et de son entourage pour que ça ait une pertinence.
Parce que, je pense, c’est souvent le problème quand on est en train d’enseigner l’histoire des guerres mondiales ou l’histoire des contacts entre Européens et Autochtones, c’est que plusieurs jeunes ne feront pas le lien avec leur vécu. J’ai trouvé ça intéressant que mes ancêtres, j’en ai un certain nombre, se sont établis à l’époque de la Nouvelle-France. En remontant dans la généalogie, j’ai pu déterminer que les Dupuis, par exemple, sont arrivés à Québec en 1650. Par la suite ont passé quelques générations à Québec, quelques générations dans la Rive-Sud de Montréal, à La Prairie.
Il y a une disparition. Pendant deux générations, on a été aux États-Unis, tout de suite après les rébellions. Est-ce que j’ai un ancêtre qui a participé au soulèvement? Ça se peut. Pourquoi ils sont allés dans l’extrême nord de New York pendant deux générations? Le mystère demeure. Pardon?
Louis : Ils se sont sauvés, finalement, pendant deux générations?
Serge : Ça se peut, je ne connais pas l’histoire. En fait, je n’ai pas fait de recherche sur cet aspect-là encore, mais des années 1830 à 1870-80, ils ont passé deux générations à New York avant de s’installer en Ontario. Une génération dans l’Est ontarien. Mon arrière-grand-père est venu, enfant, fonder– Non, mon arrière-arrière-grand-père était un fondateur du village de Saint-Charles, donc entre Nipissing-Ouest, entre North Bay et Sudbury. Ils sont arrivés dans le nord de l’Ontario en 1895, puis on a été quatre générations dans ce coin de pays là.
Juste ça, c’est une histoire intéressante. Du côté de mon grand-père, c’étaient des Irlandais. Mon arrière-arrière-grand-père qui avait émigré après la famine, par exemple. Quand on entend parler de ces mouvements mondiaux là ou de cette grande histoire-là, puis on est capable de s’y situer, je ne sais pas, j’ai l’impression que ça nous permet de découvrir notre propre histoire canadienne ou histoire franco-ontarienne à la limite.
Quand on est issu de la diversité, j’ai l’impression qu’on peut aussi trouver ce passage-là, l’existence et l’installation de ce groupe-là au Canada ou en Ontario français. Il y a des instruments pour faire de la recherche, puis Internet est magnifique pour tout ça. Ça peut nous ouvrir une porte pour aller trouver ensuite des archives qui ne sont pas en ligne, des documents qui existent en format papier.
Lorsque cette porte-là est barrée, on peut sortir une enregistreuse, on peut le faire comme ça, mais on peut aussi enregistrer avec un téléphone, on peut rencontrer des anciens. Ça, en soi, ça peut faire un projet très intéressant. Je vous dirais, quand on fait de l’histoire, quand on est capable d’avoir des sources d’époque et aller chercher un témoin aussi qui pourra complémenter ce contenu-là, on est capable de raconter une histoire qui est très intéressante, puis j’ai l’impression de nous situer dans notre monde.
[musique]
Louis : Pour entendre la suite de ce balado ou encore pour accéder aux autres balados de la série, visitez le site Internet du Centre franco et consultez l’onglet des formations offertes sous les Instituts 24/24. Il est aussi possible de retrouver le tout sur Spotify. Enfin, pour communiquer avec nous, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante : info@lecentrefranco.ca.
[musique]
2e partie du balado
Serge Dupuis : Déterminer la qualité d’une source ou remplacer une information de qualité faible par une information de qualité supérieure. J’ai l’impression que ça, c’est une compétence. Moi, je m’en sers tous les jours.
[musique]
Louis : Bienvenue aux conversations pédagogiques avec des passionnés. Initiée par le Centre Franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. Aujourd’hui, je retrouve Serge Dupuis pour la suite de notre entretien. Au début de la deuxième partie de ce balado, notre invité nous parle des compétences que l’on peut développer chez l’élève lorsqu’il est question de recherches et de travaux en histoire. Le fait de s’intéresser à l’histoire, le fait de faire de la recherche comme tu as dit, le fait de– C’est quoi les compétences, tu penses, que ça nous permet de développer chez l’élève?
Serge : C’est une question qui est grande, qui est très importante parce qu’on n’a jamais eu accès à autant d’informations et de sources au bout des doigts. Il faut développer la compétence de faire le tri entre ces sources-là, puis de pouvoir identifier, évaluer la qualité de l’information à laquelle on a accès.
Louis : Est-ce que tu– genre développer sa pensée critique, c’est ça? Quand tu dis–
Serge : Oui. C’est-à-dire que j’ai l’impression qu’on a accès à beaucoup d’informations dans les médias sociaux, par exemple dans les blogues, parmi les influenceurs par exemple, avec de l’information de qualité fort variable. On peut accéder à de la désinformation et de l’information de qualité très faible assez facilement.
Louis : D’accord.
Serge : Déterminer la qualité d’une source ou remplacer une information de qualité faible par une information de qualité supérieure. J’ai l’impression que ça, c’est une compétence. Moi, je m’en sers tous les jours. C’est-à-dire qu’on peut commencer avec une source de qualité faible, mais il ne faut pas arrêter la recherche à la première source qu’on trouve parce que l’information est toujours incomplète. Elle présente probablement des biais aussi.
Si on est capable de se tourner vers des sources d’information fiables, des encyclopédies validées, des journaux, des médias qui sont crédibles pour lesquels des journalistes professionnels travaillent, des sources qui n’étaient pas destinées à la consommation publique, mais qui devaient refléter une réalité adéquatement, comme un procès-verbal par exemple. Ce sont des sources qui sont quand même assez intéressantes, c’est un point de départ et qui nous fournit d’autres questions par la suite pour évaluer la qualité des prochaines sources qu’on va trouver, que ce soit une entrevue qu’on est en train de mener, on va être bien plus informés en posant nos questions si on est déjà allé voir ce qu’on pouvait trouver parmi les sources d’époque.
Aussi, si on est en train de trouver de nouvelles sources en ligne ou de nouvelles sources dans les bases de données, on va être capable de le dire tout de suite si ça, c’est une information de qualité égale ou si c’est une information de qualité inférieure. C’est un peu comme un travail de détective d’une certaine façon, trouver ces informations fiables-là, trouver lorsque l’information fiable n’est pas accessible, trouver une diversité de point de vue, une diversité de vécu pour reconstituer plus ou moins de façon juste ce qui s’est passé ou ce qui se passe. C’est une compétence qui est extrêmement importante parce que l’information de faible qualité est tellement accessible.
Louis : En même temps, je t’écoute, puis j’ai l’impression aussi qu’en plus d’esprit critique, il y a développer comme compétence sa créativité parce que, quand tu es face à face à une information, puis tu dis : « Okay. Là, ça, c’est la base. Comment je vais faire pour en savoir plus? » Il faut que tu sois créatif, dire : « Je pourrais peut-être– je pourrais peut-être– je pourrais peut-être– » L’autre chose que je vois aussi, c’est que tout l’aspect communication, parce que tu disais tantôt : « Aller rencontrer les témoins de notre histoire, après ça, en parler. » Il y a ça aussi, je pense. Qu’est-ce que t’en penses de ça?
Serge : Oui. C’est une occasion pour aller rencontrer des gens à qui on n’aurait pas parlé nécessairement. Entendre des histoires, des expériences encore qui ne font pas partie de notre imaginaire, mais qui peuvent faire partie de notre imaginaire. Ces temps-ci, c’est souvent l’occasion de 50ᵉ qu’on va faire des travaux mémoriels, parce que les témoins de l’époque, il y en a encore plusieurs qui sont parmi nous. À un 75ᵉ, je vais vous dire qu’il en reste à peu près plus, puis pour les centenaires, il n’en reste pas. Il faut prendre ça en compte aussi, c’est peut-être la dernière occasion de parler à ces gens-là lorsqu’un 50ᵉ arrive. On n’a pas besoin d’attendre 50 ans non plus.
On peut le faire avant, mais il y a un moyen d’entendre parler de ces réalités-là, puis pour entamer un dialogue intergénérationnel, j’ai l’impression que c’est essentiel parce que les gens ne vont pas naturellement, nécessairement parler d’eux-mêmes, puis on ne va pas nécessairement aller leur poser des questions. Ça peut sembler indiscret, sauf que si c’est dans le cadre d’un projet à l’école, il y a un prétexte pour entreprendre cette conversation-là avec grand-maman ou pour appeler quelqu’un dans une organisation qu’on n’aurait pas rencontré normalement. D’ailleurs, avec l’intelligence artificielle, la nature des travaux va changer beaucoup aussi.
À mon époque, ça se faisait écrire une dissertation sur la participation canadienne à la Deuxième Guerre mondiale ou sur les explorations de Champlain. Là, il n’y a plus personne qui va attribuer ça comme travail, parce qu’il y a trop de risque de plagiat. Ça veut dire si on a besoin d’être créatif et utiliser notre intelligence pour aller trouver de l’information. L’intelligence artificielle est un potentiel pour nous accompagner, puis nous permettre d’accéder à de la meilleure information. Moi, j’utilise les algorithmes au quotidien. On s’en sert tous, Google, mais les recherches par mot-clé dans les bases de données familiales ou dans les journaux, c’est aussi l’utilisation intelligente d’algorithmes pour accéder à de l’information de qualité rapidement.
Ensuite, comment on développe des liens entre ces informations disparates-là? Comment est-ce qu’on dégage et déduit un sens de tout ça, une analyse, une interprétation, une explication? Ça, il va falloir continuer à le faire, du moins à court et à moyen terme. J’ai l’impression que c’est une compétence qui est très importante. Il y a 20 ans, quand je terminais mon secondaire, on me disait tout simplement : « N’utilisez pas Wikipédia. Utilisez des sources fiables. » Sauf que Wikipédia peut avoir des pages de grande qualité, puis on peut en témoigner dans les références, mais aussi dans l’évaluation que Wikipédia fait de sa propre page.
Pour moi, Wikipédia est une excellente source très souvent pour se faire une tête d’un sujet, pour le comprendre, ensuite mener vers d’autres sources pour raffiner sa compréhension et créer du contenu.
Louis : Je pense que justement, si tu as plusieurs sources– Tu prenais l’exemple de Wikipédia. Wikipédia peut être une source, mais ce n’est pas nécessairement la ressource principale. C’est comme tu dis : « J’ai besoin de savoir un peu, de me faire une idée, mais à partir de là, l’autre voyage commence. » Il y a une phrase que tu viens de dire que je retiens : c’est le prof, finalement, c’est un créateur de prétexte?
Serge : Oui.
Louis : C’est tes mots à toi en passant, ce n’est pas les miens. [rires]
Serge : C’est-à-dire, les projets peuvent être des prétextes pour parler d’une histoire, pour aller trouver des sources qui sont peu ou pas utilisées, des histoires qui sont peu ou pas connues, donc on peut utiliser des travaux scolaires pour entamer des recherches, pour faire de l’histoire orale, pour faire l’histoire de son école ou de sa communauté ou de son lieu. En histoire franco-ontarienne, c’est Gaétan Gervais qui m’avait dit ça : « Tes travaux sont quasiment tout le temps pionniers, donc tu ne dois pas être intimidé parce que tu es probablement le premier à le faire ».
Effectivement, dans quasiment la totalité des projets que j’ai faits, j’étais le premier à m’intéresser à ça, parce qu’on était aussi peu à s’intéresser à cela. On avait aussi peu de ressources, ce qui n’est pas le cas, par exemple, si on était aux États-Unis ou si on était en France, où on a beaucoup de spécialistes qui s’intéressent à tout ça. En histoire franco-ontarienne, en histoire des localités, des communautés, des individus, des mouvements, on a parfois des expositions qui ont été faites en ligne, on a parfois des documents qu’on peut trouver, mais on a souvent besoin d’aller voir dans les sources nous-mêmes, puis le droit est une excellente source.
D’ailleurs, il faut passer par la plateforme de BAnQ numérique pour faire des recherches par mots-clés dans les journaux, puis le droit est inclus là-dedans. Sinon, la bibliothèque du Grand Sudbury contient Le Voyageur, donc on peut faire des recherches là-dedans puis il y a aussi les journaux de langue anglaise, donc, ça, ça peut être utile aussi de faire une recherche dans les deux langues officielles, parce que les médias ne rapportent pas nécessairement les mêmes choses. Dans les médias en anglais, quand on a des quotidiens ou des journaux qui sont publiés plus d’une fois par semaine, souvent, on couvre l’actualité.
Les francophones apparaissent dans les médias, en anglais aussi, mais on ne le couvre pas de la même manière, on ne couvre pas les mêmes sujets, mais en croisant ces deux types de sources-là, on arrive à reconstituer un passé qui est quand même assez intéressant, c’est-à-dire les sources en français ont tendance à célébrer un petit peu plus que–
Louis : Glorifier.
Serge : Oui et peut-être passer sous silence certaines affaires, certaines tensions qui sont un peu plus importantes alors qu’en contrepartie les sources en anglais vis-à-vis des francophones vont avoir tendance à être peut-être un peu critiques, peut-être même un peu négatives dépendant à quelle époque on remonte, mais ça ne veut pas dire que c’est nécessairement faux. Ça veut juste dire que dans les deux cas, l’information a été produite avec un certain biais. Comment est-ce qu’on contredit ces biais-là? En essayant de s’intéresser à l’information, aux faits, en reconstituant le passé à partir de différents points de vue.
On s’en rapproche, c’est une science inexacte. On est incapable de reconstituer à la perfection le passé, mais on est capable de s’en rapprocher en utilisant des sources de différentes natures, donc des journaux de langue anglaise et la langue française, déjà là, c’est deux points de vue. On peut faire une entrevue en histoire orale, déjà là, c’est un autre point de vue, c’est la perspective du présent sur le passé, déjà là, avec trois ou quatre sources, ça commence à être intéressant, puis ça commence à être beaucoup plus solide.
Louis : Parce que, finalement, l’histoire après que c’est passé, puis c’est quelqu’un qui la raconte, l’histoire est toujours teintée tout le temps par ce que tu dis. On va essayer de se rapprocher le plus possible, mais ça va être une version de l’histoire.
Serge : On dit que chaque génération réécrit l’histoire, c’est-à-dire qu’elle la réécrit à partir des sensibilités de son époque, ce qui veut dire que par exemple, aujourd’hui, on va écrire l’histoire en cherchant des informations sur les autochtones, sur les femmes, sur un paquet de minorités auxquelles on se serait beaucoup moins intéressé il y a 30 ans ou 60 ans par exemple, parce que ça ne faisait pas partie des sensibilités, donc c’est sûr qu’il y a toujours un biais dans l’interprétation, mais pour que ça ait un sens aujourd’hui, c’est qu’il faut que ça s’écrive pour le public d’aujourd’hui, donc d’une certaine façon, on ne peut pas écrire l’histoire de l’Ontario français comme une société dans une terre vierge.
J’exagère, là, mais il y a 100 ans, les autochtones étaient présentés au début au contact, puis c’étaient des gens qui disparaissaient de l’histoire par la suite. On ne peut plus l’écrire comme ça et c’est tant mieux parce que d’une certaine façon, on se rapproche d’une compréhension plus complète de ce que c’était à cette époque-là. C’est que ces contacts-là passaient sous silence, alors qu’aujourd’hui, on va les mettre en lumière. Ce qu’il faut éviter de faire, c’est de surinterpréter ou d’imposer nos points de vue, nos biais, nos valeurs sur ce passé-là et de fournir une information qui est plus teintée, comme vous l’avez dit.
Là, on n’est pas en train de se rapprocher, on n’est pas en train de faire un meilleur job dans l’histoire, on est juste en train de présenter une histoire avec des préjugés, avec autant de préjugés, mais ceux de notre époque au lieu de ceux du passé.
Louis : Si on revient au contexte, aux gens qui nous écoutent aujourd’hui, je suis dans ma salle de classe, je suis prof, je ne suis pas un spécialiste de l’histoire. Je suis un prof, puis ça m’intéresse, mais comment est-ce que je fais pour savoir c’est quoi les biais non conscients que j’ai quand je parle de l’histoire ? Parce que oui, je suis conscient que j’ai certains biais. Ça, il n’y a pas de problème, j’en ai, mais il y en a probablement d’autres, des biais que je ne suis même pas conscient que j’ai, alors comment on fait pour être vraiment, entre guillemets, pour ne pas que je transmette quelque chose qui est tout croche finalement?
Serge : On a nos propres biais, puis les élèves ont leurs propres biais aussi. On n’est parfois pas de la même génération. Souvent, on n’est pas de la même génération et on a chacun nos biais, nos sensibilités, nos angles morts, donc il faut réfléchir à nos propres biais, puis ensuite aux biais de la génération à qui on est en train d’enseigner puis il ne faut pas avoir peur d’indisposer, de s’indisposer soi-même ou d’indisposer les élèves–
Louis : Ça veut dire quoi quand tu dis : « Indisposer »?
Serge : Créer de l’inconfort.
Louis : Okay.
Serge : Parce que c’est dans l’inconfort qu’on apprend.
Louis : Susciter des questions finalement.
Serge : Oui, mais, c’est-à-dire, on peut ressentir des émotions par rapport à notre sujet, par rapport à des préjugés, des injustices historiques ou présentes. Je pense que c’est toujours important, s’il y a moyen, d’aller chercher un autre point de vue. J’ai l’impression que le nôtre devient plus objectif. On peut quand même avoir nos convictions politiques, mais si on est capable de comprendre un autre point de vue, on aide aussi nos incompréhensions et nos préjugés, puis on est capable de voir, de faire preuve d’empathie. Quand je dis : « Il faut avoir le courage d’indisposer sans manquer de respect », parce qu’on se prive de conversations utiles au vivre ensemble quand on fait ça.
Louis : Finalement, ce que tu dis, c’est que chaque occasion, si on y réfléchit, peut amener une conversation, peut amener une réflexion pour aller plus loin dans ce qu’on est en train de vivre. Se permettre de réfléchir, puis de discuter, puis d’avoir des conversations avec les gens qui nous entourent, ça nous permet de grandir, puis de pédagogiquement avancer. On arrive à une section du balado oû je te dis un mot et là, tu me dis deux phrases . Si par exemple, je te dis : « Ancêtre ».
Serge : C’est une personne qui a une histoire intéressante, qui peut nous informer sur le présent et nous fournir un exemple utile pour se situer dans son monde.
Louis : Excellent! Si je te dis : « La vraie histoire ». [rires] Là, tu sais que j’ai choisi des mots pour que ce soit intéressant.
Serge : La vraie histoire, si c’est possible, c’est une histoire qui est juste, qui s’inspire des informations de la meilleure qualité possible qui sont disponibles, qui reconnaît une variété de points de vue comme étant légitime et qui donne un sens à notre vécu.
Louis : Si je te dis : « Les musées aujourd’hui ».
Serge : Les musées, pour ce qui est des Franco-Ontariens, sont trop peu nombreux et trop peu fréquentés pour qu’ils fassent leur travail de rappeler ce passé unique et légitimer en quelque part les revendications contemporaines de cette petite société.
Louis : Là, je termine en disant– Parce que, quand on a discuté de ce balado, je t’ai dit que je te poserais la question : « Si tu avais un outil que tu voudrais que les gens connaissent, un outil à partager, tu nous parlerais de quel outil que tu trouves essentiel, important? »
Serge : Pour l’histoire franco-ontarienne, j’ai l’impression que ça revient beaucoup parfois à des sources secondaires. Les bibliothèques dans les écoles, les bibliothèques municipales ont plein d’informations par rapport à l’histoire locale. Par la suite, après qu’on a fait le tour de ça, c’est sûr que j’encourage les gens d’aller voir dans les bases de données, des journaux, BAnQ numérique, Le Voyageur, puis ensuite Ancestry, où on a accès à des données généalogiques et des recensements.
Enfin, troisièmement, l’histoire, qu’on est capable d’identifier des témoins qui peuvent encore nous raconter des choses qui n’ont pas été documentées, parce que c’est ça aussi qu’il ne faut pas oublier, c’est que ce n’est pas vrai que tout a été écrit. Il y a plein de choses qui existent seulement dans la mémoire des gens et qu’on a perdues par rapport à ce passé-là parce qu’on avait trop peu de médias ou trop peu d’institutions pour raconter puis conserver cette histoire-là. L’histoire orale comme source complémentaire pour complémenter l’incomplétude des sources écrites, c’est un outil aussi qui est indispensable et qui peut ouvrir l’esprit sur des idées qui ne font pas partie de notre quotidien. Ça, c’est très important.
Louis : On arrive à la conclusion. Je pourrais faire une très belle conclusion de ce balado, mais je vais te laisser faire. Si tu avais à résumer notre rencontre aujourd’hui ou encore à dire : « Essentiellement, voici ce que je dirais en conclusion– » tu as la chance de conclure notre balado.
Serge : Pour qu’un élève voie la pertinence de l’histoire, il ou elle doit voir son histoire comme étant légitime, intéressante et pertinente. Ce lien-là entre l’histoire de ses origines, de ses ancêtres, de son école, de sa communauté, peu importe, et la grande histoire qu’on enseigne à l’école, il me semble que c’est le lien essentiel à faire pour qu’on voie la pertinence du passé et qu’on s’en inspire pour imaginer l’avenir.
Louis : Serge Dupuis, historien, membre de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture de l’expression française en Amérique du Nord, je te remercie pour ce moment où on a discuté ensemble. Ma conclusion, c’est une phrase que t’as dite, que je retiens, c’est que : « L’histoire, ce n’est jamais passé, ça fait partie du présent ». Merci et à la prochaine!
[musique]
Merci d’avoir écouté ce balado. Pour avoir accès aux autres balados de la série, visitez le site internet du Centre franco. Vous pouvez aussi avoir accès aux différents balados sur Spotify. N’oubliez pas enfin qu’il est toujours possible de communiquer avec nous en utilisant l’adresse courriel suivante : info@lecentrefranco.ca.
[musique]