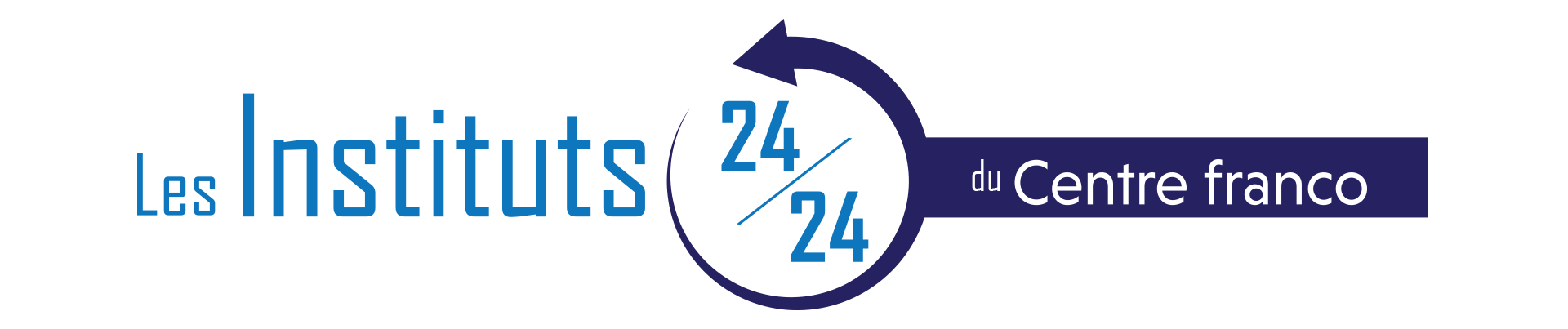À la rencontre d’André Savard – L’empathie, la diversité et l’inclusion!
Épisode 10
André Savard travaille au sein du système d’éducation franco-ontarien depuis plus de 30 ans. Il a occupé successivement des postes d’enseignant, de conseiller pédagogique, de directeur pédagogique et de directeur d’école. Il a travaillé autant dans les communautés scolaires du primaire que dans celles du secondaire, puis a supervisé, à titre de directeur, l’ouverture de deux nouvelles écoles.
Entre 2015 et 2023, il a occupé le poste de leader pédagogique au sein de l’équipe provinciale TacTIC du Centre franco. Il a accompagné de nombreuses directions d’école ainsi que des équipes pédagogiques en vue d’appuyer la mise en œuvre de projets innovants centrés sur le développement des compétences, la transformation des pratiques pédagogiques, de même que l’utilisation d’outils et de ressources numériques.
Depuis 2019, André occupe une partie de son temps en étant directeur en leadership et en programmes internationaux chez Idée éducation entrepreneuriale. Il croit profondément à l’importance d’une école communautaire qui engage l’élève, à tous les âges, dans des projets authentiques et signifiants. En somme, dans des projets qui répondent aux besoins et aux aspirations des jeunes d’aujourd’hui. Il suit ainsi les changements et la transformation des pratiques pédagogiques dans divers milieux éducationnels d’Afrique et d’Europe. Il est passionné de leadership, de transformation organisationnelle, de principes associés à l’école communautaire entrepreneuriale et de développement des compétences.
Le Centre franco est sur Spotify!
Écoutez le balado d’André Savard en cliquant sur la première partie et/ou la deuxième partie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode!
1re partie du balado
André Savard : Je pense que l’écoute est quelque chose, en tout cas, d’essentiel, à mon avis, d’être capable d’entendre, d’écouter, sans essayer de donner des recettes, sans essayer d’expliquer qu’est-ce que tu devrais faire, prochaine étape, bla bla bla. Juste écouter, prendre le temps d’écouter les gens.
[musique]
Louis : Bienvenue aux conversations pédagogiques avec des passionnés! Initiée par le Centre franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. J’ai le plaisir aujourd’hui de parler avec André Savard. Vous allez voir que c’est une personne qui a un parcours très intéressant. André, on peut dire qu’il est tombé dans la marmite de l’éducation au début, comme moniteur de langue à Manitoba, pour devenir plus tard enseignant. Il nous dit alors qu’il apprend constamment de ses élèves. André travaillera ensuite comme conseiller pédagogique, puis deux ans plus tard, il se retrouvera à la direction de service pour le Conseil scolaire Mon avenir, dans le sud de l’Ontario. Après, il occupera pour une quinzaine d’années le poste de direction d’école pour terminer son parcours avec l’équipe provinciale tactique au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Aujourd’hui, il continue, quelques fois par année, aux quatre coins du monde, particulièrement en Afrique, à travailler à titre de consultant en éducation. Rencontrons ensemble André Savard. Bonjour, André!
André Savard : Bonjour, Louis! Quel plaisir d’être avec toi cet après-midi!
Louis : Merci d’avoir accepté de participer à notre balado. Est-ce que tu peux me parler de deux passions que tu as comme personne?
André : La composante de rencontrer une autre culture, de rencontrer des gens qui sont différents, est quelque chose qui me passionne. Évidemment, je suis tombé dans le carré de sable de l’Afrique quand j’avais 22 ans. J’ai eu la chance de voyager à différents moments. Comme tu le dis, encore aujourd’hui, j’y vais à peu près une à deux fois par année depuis les trois dernières années. C’est de baigner dans la différence que je trouve inspirant. Entre toi et moi, Louis, si l’on parle de différentes choses, toi et moi, on risque d’avoir des référents très comparables. Qu’on parle de la politique, qu’on parle des relations familiales, qu’on parle de la relation avec les enfants, peu importe, on va avoir de très belles discussions. Nos référents sont relativement semblables. On va s’apprendre des choses à un certain point, mais quand tu voyages, tu rencontres des cultures de différents– Tu sors un peu de l’Europe, qu’on va vers l’Afrique, l’Amérique latine, que l’on aille vers l’Asie, c’est des occasions– Soudainement, tes référents, c’est plus que de l’habitude.
Louis : Ils sont brassés un peu, nos référents, parce qu’on [diaphonie] à les retrouver.
André : Exactement. Ça peut être à la fois confrontant, mais, en même temps extrêmement enrichissant parce que tu te rends compte que le monde qui nous entoure n’a pas nécessairement la même vision des choses, n’a pas nécessairement la même représentation de ce qui se passe autour de toi. C’est aussi enrichissant de le découvrir. Ça te dit beaucoup plus sur toi-même aussi. Moi, cette passion-là a toujours été d’une grande inspiration. La communauté africaine, comme j’ai baigné beaucoup là-bas, a été probablement la source la plus importante de mon cheminement, puis de la vision que je me suis donnée de la vie.
La façon que je vois l’importance d’accueillir la personne différente, toute la question de l’empathie, la question d’être ouvert d’esprit, la question de se dire– Des fois, je peux être surpris par des choses que je ne m’attendais pas parce que le point de vue qui est en avant de moi est différent. J’ai tout le temps eu une tendance à essayer de marier les différents éléments les uns avec les autres pour, en tout cas, donner plus d’accordéons, pour que ça s’accorde, pour que ça fasse du sens. Ça, c’est une de mes passions.
Louis : Tu as utilisé une expression, tu dis « baigner dans la différence ». C’est une super belle expression, ça, je trouve. Est-ce que tu penses que ça s’apprend, ça? Parce que la différence, pour certaines personnes, ça peut faire peur. Au contraire, ça peut encourager la découverte, ça peut nous amener sur des sentiers super intéressants. Est-ce que tu penses que ça s’apprend? Comment on fait quand on est– Parce que, les deux, on a baigné dans le monde de l’éducation. C’est une valeur, l’acceptation de l’autre. Comment on fait pour favoriser ça chez l’autre?
André : À mon avis, Louis, ça ne s’apprend pas dans les livres, c’est clair, ça s’apprend dans l’action. Il faut être présent à la différence pour la vivre et la comprendre. À mon avis, ça ne s’apprend pas dans les livres. Je me rappellerai toujours une des raisons pour laquelle j’étais parti du côté de l’Afrique. Un de mes enseignants en géographie, j’étais à l’université, tout bonnement, c’était un professeur que j’aimais beaucoup, il avait dit : « La géographie, ça s’apprend par les pieds. » Et puis, j’ai écrit un billet de blogue là-dessus à un moment donné, d’ailleurs, avec le Centre franco. Je trouvais ça très inspirant. Il avait dit ça. Pour moi, c’est un peu la même chose. La différence, ça s’apprend par les pieds, par les mains, par nos oreilles, par nos goûts, par nos yeux, par nos sens. La différence, ça s’apprend par nos sens.
Louis : Franchement, ça pourrait être le titre d’une conférence.
André : [rires] Je pense, en tout cas, que c’est comme ça. Pas juste par la différence, mais par l’accueil de la différence. C’est ça qui permet de donner du sens, je pense à l’accueil des choses. En éducation, dans un poste de direction ou, peu importe, comme enseignant, combien de fois on fait face à ça? C’est des jeunes qui nous proviennent de milieux qui sont très différents de ce qu’on a pu connaître nous-mêmes, des jeunes qui proviennent d’ailleurs, d’autres pays, des jeunes qui vivent des choses difficiles dans leur vie, et cetera. Ça, ça crée tout un monde de gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous, qui fait en sorte qu’on a tout avantage à tirer expérience de ça, tirer profit de ça.
Louis : Est-ce que tu penses que, certaines compétences qu’on devrait développer ou aider à développer chez l’autre, pour favoriser cet accueil de la différence? Parce que, pour certaines personnes, la différence, ça peut faire peur. Quelles compétences, tu penses, qu’on devrait favoriser chez l’élève ou même chez l’adulte pour que ça soit plus facile?
André : Je pense que la compétence, tout ce qui touche la composante socio-émotionnelle, c’est notre capacité un peu de gérer nos émotions, de comprendre les émotions de l’autre. Je pense que c’est une compétence qu’on entendait beaucoup parler il y a peut-être trois, quatre, cinq ans passés. On en entend un peu moins parler maintenant, mais elle fait quand même partie de toute la question de citoyenneté, notre capacité d’être dans le monde, et cetera. Ça, je pense que c’est riche cette composante-là de la compétence socioémotionnelle parce que tu as raison, des fois, face à la différence, je l’ai vu dans mes milieux de travail où j’étais direction, j’ai grandi beaucoup dans la région de Toronto, qui est très diversifié, aller dans une école, le personnel était très différent.
J’avais des gens qui provenaient d’un peu partout. Je me suis rendu compte assez vite, avec un grain de pincement, on a envisagé des réflexions autour de ça, dans lequel les gens avaient tendance à se regrouper entre eux. Les gens d’un certain coin de pays, ils mangeaient davantage ensemble. Même, des fois, ils se retiraient. Que l’on vienne de l’extérieur ou qu’on soit de l’intérieur, entre guillemets, si on le dit comme ça, ce n’est pas plus facile d’accueillir la différence de l’un ou de l’autre. C’est faux. Il y a cette tendance peut-être pour se retrouver, pour avoir un sentiment de sécurité. On a tendance à se rassembler avec les gens qu’on connaît ou les gens qui nous ressemblent.
Louis : C’est vrai ce que tu dis. Souvent, ce qui aide, si tu l’as vécu, cette différence. Je me souviens comme élève, j’ai un œil que je ne vois pas. J’étais pourri au sport, fait que je ne l’avais pas, ça. Puis, ce sentiment-là : « Tu n’es pas pareil, et cetera. » À un moment donné, parce que tu l’as vécu, tu es très sensible à ça quand tu y arrives ou tes yeux– Je disais toujours, j’étais aveugle, mais mes yeux étaient plus ouverts pour voir de telles situations comme ça, et ça favorise, à un moment donné, justement, cette petite lumière dans le cerveau qui dit : « Oui, mais c’est vrai. » La différence peut être intéressante parce que finalement tout le monde a des différences, on est tous différents de quelque chose. C’est ça qui fait la richesse à un moment donné.
Je trouvais ça très intéressant que tu me parles de ton prof de géographie parce que, dans mon cas, c’est aussi un prof de géographie qui a une grande influence dans ma vie en septième et en huitième année. Il nous demandait d’amener des articles de journaux de différents pays. C’est ça qui a fait que je me suis ouvert sur le monde, c’est en septième ou en huitième année. On dit même que ça aurait même influencé le fait que j’ai adopté des enfants à l’international par la suite.
André : Intéressant.
Louis : Je trouve ça– Oui, vas-y.
André : J’allais juste dire, c’est tellement facile d’avoir des œillères, malheureusement– De se mettre des œillères pour rester confortable. Parce que c’est vrai que c’est confortable d’être avec les gens qui pensent comme nous, qui voient les choses à peu près semblables à nous. Quand on rouvre les œillères, tantôt, tu disais qu’il y a un œil que tu vois moins bien. Quand tu ouvres les œillères, tu vois des perspectives différentes, tu vois beaucoup plus large. Quand tu as les œillères– Quand on en met un cheval, c’est pour qu’il regarde en avant, pour pas qu’il voit le trafic à côté, pour pas qu’il voit des gens qui bougent, mais quand tu enlèves les œillères, tu es capable. En éducation, j’ai l’impression que c’est essentiel.
Louis : Tu as parlé aussi, à un moment donné, de l’importance de l’empathie. Comment on fait pour développer ça chez nos élèves ou même avec les adultes autour de nous? Parce que je pense que ça va ensemble avec accueillir la différence, être empathique, avoir une bonne écoute. Comment ça se développe?
André : C’est une bonne question. J’ai l’impression qu’il faut faire vivre des choses aux jeunes. Pour leur faire vivre des choses, il faut faire vivre des expériences à nos enseignants pour qu’ils connaissent l’autre, qu’ils sachent un peu qui sont les personnes qui l’entourent. Pour les jeunes, je trouve que c’est beaucoup dans l’action. Il y a plein de projets qui se font dans les écoles. C’est des jeunes qu’on amène rencontrer des personnes âgées. Il y a des jeunes qui vont aller vivre dans des soupes populaires, rencontrer des gens qui ont peut-être des difficultés particulières.
Non seulement de le faire vivre aux jeunes, mais après ça, d’être capable de revenir là-dessus et d’en discuter. C’est de voir comment on s’est senti, réfléchir sur le pourquoi de ces situations-là, alimenter ces choses-là, je pense que ça peut favoriser l’empathie. Je pense que, généralement, les jeunes, en tout cas d’aujourd’hui, ont une ouverture que je trouve très grande. Beaucoup de mariages entre des jeunes qu’on retrouve dans les écoles qui se fréquentent dans le sens où ils sont des amis, ne voient pas nécessairement– Tout comme quand j’étais enseignant même, je me rappelle très bien que tout le monde était très accueillant les uns des autres, beaucoup plus que peut-être certains adultes un peu plus âgés. Les préjugés qu’on développe, je ne sais pas d’où ça vient. En tout cas, nos préjugés, dans notre société, il y en a. Je n’en doute pas qu’il y en a encore, mais j’ai l’impression que les jeunes sont plus sensibles à tout ça. Ils sont plus conscients de ces choses-là, naturellement.
Louis : Je vais t’emmener ailleurs, André, parce qu’on a eu la chance d’être à la direction d’école. C’est quoi, selon toi, entre guillemets, une bonne direction d’école ou une direction d’école efficace? Qu’est-ce que ça prend pour être une direction d’école qui fait une différence?
André : Il n’y a tellement pas de recette magique, mais une chose est certaine, c’est que tu dois être une personne qui est en mesure d’écouter. Je trouve que c’est un privilège quand on est direction d’école. C’est un privilège de pouvoir être en contact avec des parents, d’être en contact avec des enseignants, d’être en contact avec des jeunes et d’entendre des choses que d’autres n’entendent pas. J’ai vu des parents qui sont venus me rencontrer dans mon bureau, qui pleuraient, qui étaient tristes pour des raisons liées à la relation qu’ils avaient avec leurs enfants ou à des difficultés qu’ils vivaient dans le milieu du travail.
La même chose avec des enseignants qui vivent parfois des choses difficiles. Je pense que l’écoute est quelque chose de bien, en tout cas d’essentiel, à mon avis, d’être capable d’entendre, d’écouter sans essayer de donner des recettes, sans essayer d’expliquer qu’est-ce que tu devrais faire, prochaine étape. Juste écouter. Prendre le temps d’écouter les gens et de sympathiser avec eux, de s’associer un peu à leur peine, à leur tristesse ou à leur joie. Parce que, ça, il y en a aussi. Il y en a autant que–
Ça, je pense, c’est important la composante de l’écoute. L’autre élément qui est important, c’est d’avoir une forme de vision pédagogique, c’est-à-dire d’avoir une profondeur pédagogique. C’est-à-dire que j’ai réfléchi. J’ai eu l’occasion d’expérimenter des choses dans ma salle de classe, peut-être comme enseignant, que j’ai eu la chance de lire un certain nombre de livres, que j’ai peut-être été dans des conférences. Je me suis fait une tête au plan pédagogique, pas au plan de la gestion, mais au plan pédagogique.
Non pas que la gestion n’est pas importante, mais, vraiment, elle peut être assez secondaire dans une école si on le décide comme direction d’école. Tu sais, elle peut être très secondaire parce que notre centrale est beaucoup au niveau, à mon avis, la composante pédagogique. Ça, c’est, à mon avis, un autre morceau qui est important. L’important de savoir fait une tête par rapport à la question de la pédagogie. Tu commences ces deux morceaux, l’écoute, la composante pédagogique– Bien que je dis ça, de s’être fait une tête, il faut être vraiment conscient que ça évolue tellement rapidement que notre tête est appelée à changer. Fait qu’on a parlé longtemps, puis on en parle encore, parfois, de la mentalité de croissance.
C’est d’avoir une mentalité dans laquelle que ce que je crois aujourd’hui, ça se pourrait que ça se modifie un peu, ça se pourrait que je continue de le construire, de l’alimenter, donc d’avoir une espèce de perspective de chercheur continuel, d’une personne qui peut constamment vouloir apprendre davantage, et cetera. À mon avis, ça aussi, c’est une composante importante d’une direction d’école.
Louis : Là, je ne sais pas si tu vas être d’accord avec moi. En plus, j’ai l’impression aussi qu’il faut se battre contre l’isolement. Parce que, souvent, un directeur d’école se retrouve à la tête tout seul. Je ne sais pas qu’est-ce que tu penses de ça? L’importance d’avoir des collègues, l’importance de consulter, l’importance de– Quand on prend des décisions, ne pas le faire tout seul. Qu’est-ce que tu penses de tout ça?
André : Dans l’évolution actuelle des choses, à mon avis, les responsabilités des individus dans une école, bien qu’elles soient différentes, on devrait vraiment être capable d’avoir le plus de transparence possible les uns avec les autres. À mon avis, on s’en va dans cette direction-là, d’avoir le plus de transparence possible par rapport à ce qu’on peut vivre, par rapport à des questions budgétaires, par rapport à des questions d’orientation, des questions de difficultés qui peuvent suivre au sein d’écoles. Je pense qu’il faut avoir cette idée un peu, beaucoup de transparence les uns avec les autres. Ceci étant dit, tu as tout à fait raison. Je veux dire, ça te prend quand même un réseau rattaché à tes responsabilités d’école.
Parce que ces responsabilités-là, elles ne sont pas toujours comprenables par les gens qui nous entourent parce qu’ils vivent d’autres genres de responsabilités pour lesquels moi-même, même si j’ai passé comme enseignant– Je veux dire l’enseignement 15 ans après que j’ai été à la direction est plus pantoute comme ce que moi, j’avais. Ça aussi, c’est des responsabilités pour lesquelles– Des fois, il y a des choses que je ne peux pas nécessairement saisir, mais que le personnel enseignant, entre eux, sont capables de le faire. C’est un peu la même chose pour nous comme direction. D’avoir des réseaux de direction, d’avoir des associations de direction comme on a provincialement, d’avoir des formations qui nous mettent ensemble, qui nous permettent d’échanger.
En tout cas, je conseillerais à n’importe quelle direction d’avoir un bon mentor, une personne qui l’apprécie, puis d’être capable d’échanger avec elle.
[musique]
Intervenant : Pour entendre la suite de ce balado, ou encore pour accéder aux autres balados de la série, visitez le site Internet du Centre franco et consultez l’onglet des formations offertes sous les Instituts 24/24.
Il est aussi possible de retrouver le tout sur Spotify.
Enfin, pour communiquer avec nous, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante : info@centrefranco.ca.
[musique]
2e partie du balado
André Savard : Plein d’enseignants, après un certain nombre d’années qui sont souvent courtes, quittent la profession. Je pense que c’est parce que tu as dit un mot tantôt important, ils se sentent isolés.
[musique]
Louis : Bienvenue aux conversations pédagogiques avec des passionnés. Initiée par le Centre franco, cette série de balados nous présente des professionnels qui excellent en éducation. Aujourd’hui, je retrouve André Savard pour la suite de notre conversation. Au début de la deuxième partie de ce balado, je pose la question afin de savoir ce qu’il ferait avec une nouvelle personne enseignante qui commence dans la profession. Par la suite, j’aborde l’utilisation de la technologie à l’école avec lui.
[musique]
Si, aujourd’hui, André, tu te retrouvais encore à la tête d’une école, puis tu avais une jeune personne enseignante qui commence, qui arrive dans ton école, même si tu as dit : « Oui, ça a bien changé », ça serait quoi les conseils que tu oserais lui donner?
André : Dans un premier temps, ce que j’aimerais, ça serait vraiment d’avoir une discussion avec elle, puis de comprendre un peu ce qui l’a amenée dans l’éducation. Qu’est-ce qui fait qu’elle aime, qu’elle a choisi cette profession-là ou qu’elle s’est investie dans ça, et cetera. J’aimerais avoir cette conversation-là avec elle. Savoir un peu d’où elle vient, ce qu’elle fait, le pourquoi qu’elle fait ça. Ça, ça me donnerait déjà de bonnes pistes.
Je lui demanderais certainement les inquiétudes qu’elle peut porter en ce moment. Comme nouvel enseignant, qu’est-ce qui la préoccupe? J’essaierais vraiment de lui trouver une collègue qui, je sais, pourrait peut-être aussi l’aider ou l’appuyer dans les préoccupations qu’elle a. Est-ce que je lui donnerais des conseils? En tout cas, j’essaierais de lui donner certainement des ressources pour la soutenir, d’essayer d’être présent avec elle, si elle le souhaite, à différents moments. J’essaierais beaucoup de la connecter avec des membres du personnel enseignant pour qu’elle s’intègre rapidement au milieu scolaire dans lequel elle vient parce que c’est lui qui va l’aider le plus.
Je vais certainement l’appuyer, c’est certain, mais plus grand encore, ses collègues vont l’appuyer. Si elle peut bien s’intégrer à son milieu, aux gens qu’elle a autour, si elle est capable de poser des questions, si elle est capable d’exprimer ses inquiétudes, si elle est capable d’aller chercher des ressources, puis du soutien auprès des gens à qui elle peut faire confiance. Je voudrais créer des liens de confiance entre elles, puis les gens.
Louis : Je trouve ça très intéressant, André, parce que, dans tout ce que tu as dit, pour l’aider, tu ne lui as pas donné de conseils, genre : « Fais ci ou fais ça. » Si j’ai bien entendu, puis bien compris ce que tu as dit, c’est surtout que, par elle-même, elle crée un contact avec une collègue, qu’il y a des gens qui puissent répondre à ses questions. J’ai entendu beaucoup d’écoute et d’ouverture par rapport à ce que tu lui as offert comme conseils.
André : C’est certain que, si elle me demande des conseils : « André, qu’est-ce que tu ferais? Qu’est-ce que tu peux faire avec un élève dans la salle de classe qui n’écoute pas? J’ai bien de la misère avec lui, puis je ne sais pas. » C’est sûr que je ne lui dirais pas : « Va en parler avec– » On en jaserait, puis on essaierait de regarder des stratégies. Je pense, en tout cas, de créer autour d’elle un milieu qui va la soutenir. Parce qu’on le sait, Louis, il y a plein d’enseignants, après un certain nombre d’années qui sont souvent courtes, qui quittent la profession.
Je pense que c’est parce que tu as dit un mot tantôt important, ils se sentent isolés. Il ne faut pas qu’ils soient isolés. Il faut leur permettre de se sentir dans un groupe, dans un réseau, accueilli avec lequel ils pourront avoir du soutien.
Louis : Comme outils, c’est quoi ta position par rapport à l’utilisation de la technologie? Parce qu’on est dans un monde de plus en plus technologique, et il y a différents courants. Qu’est-ce que tu penses par rapport à l’utilisation de la technologie à l’école?
André : Louis, le défi qu’on a, c’est que, moi, je trouve que c’est une fausse question. C’est vrai qu’elle se pose en société actuellement, on voit toutes sortes de tendances. Je trouve que c’est une fausse question parce que ce n’est même pas une question, c’est un fait. C’est un état de fait. Qu’elle le soit à l’école ou qu’elle ne le soit pas, elle est présente, puis les jeunes, ce n’est pas parce que l’école va l’interdire qu’ils ne l’utiliseront pas.
C’est un état de fait. Quand il y a un état de fait, tu as deux possibilités. Soit que tu dises : « Je refuse de voir ça, le fait, et je m’éloigne » ou bien j’ai l’option de dire : « C’est un état de fait, ça fait partie de la réalité. De quelle manière on va aménager ça dans le milieu où on se trouve? », que ça soit à l’école, que ça soit dans un milieu de travail, que ça soit dans une industrie privée, et cetera. Ce sont des états de fait, à mon avis, en tout cas.
Je ne suis pas du tout en faveur de dire qu’on va commencer à interdire, on va commencer à– C’est sûr qu’il y a plein de nouvelles choses qui arrivent qui peuvent un peu nous inquiéter, puis il faut apprendre à vivre avec. Je n’ai pas de réponse magique. Que ça soit l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, toutes ces choses-là, ça va impliquer des changements, à mon avis, importants en éducation. On ne peut pas juste fermer l’œil, puis de dire : « Ça n’existe pas. » À mon avis, en tout cas.
Louis : Surtout que nos élèves l’utilisent aussi.
André : Tout dernièrement, je te disais que je travaillais du côté de l’Afrique. Il y a des jeunes qui, pendant un examen, parce qu’on avait de petits tests, puis des petites choses, ils ont utilisé l’intelligence artificielle. Avec tout ce que ça implique au plan éthique, il a fallu jaser avec eux, puis tout ça. Il reste que les jeunes l’utilisent, même du côté de pays en dehors de l’Amérique. Les jeunes sont conscients de ça, peut-être plus que leurs profs.
Louis : Oui, c’est ça. Je donne toujours cet exemple-là, où est-ce que c’était un ou une conseillère pédagogique qui est rentré dans une classe. Il demande au prof : « Puis, l’utilisation de l’intelligence artificielle? » Là, le prof ne dit rien, mais tu entends les élèves qui disent : « Ne parle pas de ça, monsieur ou madame. » Parce que nous, on l’utilise justement. Ça m’amène à cette question-là très intéressante : Comment tu vois l’avenir en éducation? Là, on pourrait prendre plein de chemins, mais allons-y du côté pédagogique de la chose : Comment tu vois ça?
André : Je vais finir par le plus important, mais je commence par–
Louis : On va commencer, mais après, on va finir. C’est ça que je comprends. [rires]
André : L’avenir de l’éducation, c’est intéressant parce qu’il me semble que c’est une question qu’on pose depuis les 30 dernières années. À tous les 10 ans, on a comme un–
Louis : Même plus, je pense. Je pense que ça fait plus longtemps qu’on se pose cette question-là.
André : Oui, c’est ça. Je le mets à 30 ans parce que ça a été à peu près le temps de ma carrière, mais c’est comme des– Là, j’ai quand même l’impression, Louis, qu’on est dans une situation particulière. Il y a vraiment quelque chose qui va faire en sorte que l’éducation, à mon avis, va être différente. Il y a d’abord toute la question– C’est sûr que la technologie puis l’éducation, on en parlait tout à l’heure, va nous amener sur différents types d’apprentissages, des apprentissages hybrides, pas juste en relation avec l’école.
Un jeune peut apprendre de bien des manières, puis il connaît ces manières-là : à travers les réseaux sociaux, à travers l’accès à des cours, à travers toutes sortes de possibilités. Ce qui fait que la technologie, les types d’apprentissages vont être extrêmement variés.
Évidemment, quand on rattache technologie-éducation, on en parlait tout à l’heure, toute l’intelligence artificielle va apporter un paquet de choses qu’on n’a pas encore tout à fait découvertes. On a même du mal un peu à s’imaginer jusqu’où ça peut aller pour de l’appui individuel à des jeunes, la capacité d’avoir quelqu’un avec qui converser. Il y a toutes sortes de possibilités qui vont s’ouvrir à des jeunes qui vont avoir un impact assez significatif, je pense, sur même la façon dont les parents vont voir l’école. Ils vont peut-être même se poser la question, les parents : « C’est nécessaire que mon enfant aille à l’école? » Telle qu’on la conçoit, surtout si cet enfant-là est un peu malheureux, et cetera.
Ça, ça va ouvrir à toutes sortes de possibilités. L’autre élément, toutes les pédagogies innovantes qu’on a connues, je pense, vont devoir prendre une ampleur importante. Toute la question d’un apprentissage plus lié par projet. Un apprentissage qui se veut davantage authentique, qui se veut plus dans les milieux communautaires aussi, dans lesquels l’enfant peut apprendre à travers sa relation avec sa communauté, avec ce qui l’entoure, et cetera.
Toute la question des compétences, je pense, va prendre aussi une ampleur importante. Les compétences numériques, toute la question, on en parlait tout à l’heure, de la compétence socioémotionnelle. Toute la capacité de penser de façon critique, puis de résoudre des problèmes, je pense, va devenir importante. D’être critique à l’égard de ce qui nous entoure. Ce qui nous est offert d’une façon, des fois, un peu déconcertante, je pense qu’il faut être critique à l’égard de tout ça. Il va falloir apprendre à nos jeunes à le demeurer, puis nous-mêmes, comme adultes, à être aussi critiques à l’égard de toute l’information qu’on peut recevoir.
Les compétences transférables vont jouer un rôle important. On sait que ces compétences-là se jouent dans l’action, se développent dans l’action, se développent dans l’expérience, dans l’expérimentation, et cetera. L’autre élément, je pense que c’est peut-être le plus important, ça va être d’envisager un accès équitable à l’éducation. Ce que je veux dire par là, c’est toute la question de l’inclusion puis de la diversité.
On va de plus en plus, à mon avis, vivre dans un monde où l’on va avoir des gens qui nous proviennent d’ailleurs, des cultures, des façons de penser qui sont différentes. Même au sein de nos propres communautés, avec nos jeunes, il y a toutes sortes d’orientations aujourd’hui, toutes sortes de façons de penser de la part des jeunes, toutes sortes de manières d’envisager un peu la–
On va faire face à beaucoup de diversités. J’ai l’impression que toute la question d’offrir à tous ces gens-là une éducation équitable, pour ne pas avoir de préjugés ou de biais à l’égard de ces personnes-là, va être, à mon avis, un enjeu important dans les prochaines années. Toute la question de développer des réseaux de soutien communautaire aussi. Ça, je pense que ça va être vraiment important.
En tout cas, moi, dans mon expérience actuelle avec l’éducation entrepreneuriale, je pense que c’est une compétence qui va être importante. Toute celle du bon, du citoyen mondial, puis de l’éducation plus entrepreneuriale où tu impliques la communauté le plus possible dans l’apprentissage des jeunes, ça, je pense que ça va devenir important. Que les jeunes aient des projets qui leur permettent de changer des choses autour d’eux. Que tu sois petit ou que tu sois grand, je pense que tu peux déjà agir dans ton milieu. Des fois, ça peut être dans ta salle de classe.
Tantôt, on parlait d’empathie. Quand on fait ça, je pense qu’on développe aussi l’empathie des jeunes. Quand on leur donne la chance de voir qu’est-ce qu’ils peuvent transformer autour d’eux, qu’est-ce qu’ils pourraient faire de mieux pour aider, pour appuyer quelque chose, quelqu’un, et cetera. Pour moi, ça, ça va être des enjeux majeurs dans les prochaines années. Peut-être plus que tout ce qu’on a vu auparavant. Ça va être l’inclusion de la diversité, d’être capable de soutenir des réseaux ou, en tout cas, d’avoir de bons réseaux communautaires.
Louis : Je trouve ça très intéressant parce que, moi aussi, je pense qu’on est à un moment critique, même si tout le monde dit– Je me souviens, puis tu l’as dit tantôt, quand on a commencé à enseigner, certaines personnes qui prenaient leur retraite disaient : « Je ne sais pas comment vous allez faire. » Ils trouvaient que ça avait tellement changé depuis 30 ans, puis, si l’on regarde, nous autres, la même chose, 30 ans plus tard, on dirait qu’on est à l’aube de quelque chose de différent, et cetera.
Je pense que la question– Tu avais dit, la conclusion à la fin, ça va être super important. Moi, je pense qu’on le voit déjà l’importance de donner une chance, un accès équitable à tous les domaines, à chaque enfant à l’école. Parce que tu te dis, tu étais en Afrique, et cetera, puis déjà, on le voyait. Dans nos milieux aussi, est-ce que chaque élève a une chance équitable de réussir? Chaque école? « J’ai choisi telle école parce que– » Ça veut dire que l’autre est « parce que »? D’être conscient.
Ce que j’entends dans ce que tu dis, c’est : chance équitable, inclusion, diversité. C’est tous des éléments qui vont être super importants parce que, que tu aies la meilleure pédagogie au monde, si tu n’es pas conscient de ça, ça se peut qu’il y ait des petits cocos, puis des petites cocottes dans ta classe qui n’apprennent pas-
André : Qui se sentent exclus.
Louis : -qui se sentent exclus, et cetera. André, on est déjà rendu à la partie du balado où je te donne un mot et tu me donnes deux-trois phrases. Si je te dis, premier mot, « le manuel scolaire ».
André : C’est un outil peut-être dépassé, mais qui existe encore. Il faut savoir s’en servir d’une façon intelligente.
Louis : Si je te dis « un bon parent »?
André : Je dis trois mots : amour, amour, amour.
Louis : Développe un petit peu.
André : Je savais que tu étais pour dire ça.
[rires]
Un bon parent ou un parent tout simplement?
Louis : Un bon parent.
André : Un bon parent. Je pense qu’un bon parent, c’est d’abord et avant tout une personne qui va être attentive, qui va être ouverte, puis qui va donner de la liberté à son jeune d’expérimenter des choses, de tenter des expériences, d’accepter que l’enfant va faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Même comme adulte, on en fait régulièrement. Oui, un peu ça. Tout ça doit tellement se faire– Oui, je riais bien, mais il faut vraiment que ça se fasse beaucoup dans l’amour. L’amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nonobstant ce que l’autre va faire, il aura toujours la porte ouverte. Jamais tu ne vas fermer la porte. C’est ça.
Louis : Si je te dis « apprendre autrement ».
André : Je pense à explorer. Apprendre autrement, pour moi, c’est de faire de l’exploration, c’est d’être capable de découvrir, de partager, de profiter un peu de l’intelligence collective. Qu’on soit des plus petits ou des plus grands, de faire profiter l’intelligence collective des uns et des autres.
Louis : Selon toi, le plus grand biais en éducation?
André : Le plus grand biais en éducation? Ce n’est pas simple, ça. Pourquoi tu poses cette question-là, Louis, le plus grand biais en éducation? Il peut y en avoir un certain nombre.
Louis : Un biais. On va enlever le plus grand, on parle d’un biais.
André : C’est de croire que les êtres humains ou que les élèves peuvent avoir certaines limites. Ils peuvent avoir certaines limites, puis ça nous met dans une position un petit peu préjudiciable à l’égard de ces personnes-là.
Louis : Merci. Le dernier, ça serait quoi une phrase ou quelques phrases que la personne enseignante pourrait dire à ses élèves avant qu’ils s’en aillent? C’est la fin de l’année, c’est terminé, et cetera. Ça serait quoi?
André : Ça serait sans aucun doute–
Louis : À part de : « Bonnes vacances! »
André : Oui, de les remercier d’avoir été là avec elle ou avec lui pendant toute l’année, d’avoir accepté de cheminer les uns avec les autres, puis d’avoir découvert des choses. Je donnerai peut-être la chance aux jeunes de donner aussi leur coup de cœur de l’année, puis qu’on les nomme, qu’on les écrive, qu’on fasse de quoi avec ça. Je ferais ça comme activité, je pense, à la fin de l’année.
Louis : On les célèbre, peut-être?
André : Absolument, oui.
Louis : André, parce que je sais que tu es une personne qui est constamment en train de travailler ton développement professionnel, et cetera, est-ce que tu pourrais nous partager deux ressources qui vaudraient la peine vraiment de regarder parce que tu dis : « Ça, c’est bon. »?
André : Je t’ai parlé de deux choses que j’aimais beaucoup, Louis. On a parlé de l’Afrique, entre autres, et cetera. Il y a un livre que j’ai lu tout dernièrement de Kémi Séba, qui s’appelle La philosophie de la panafricanité fondamentale. C’est un livre un peu de philosophie, mais vraiment simple à lire, qui nous donne une perspective de la perception ou de la représentation que se font des Africains, pas tous, mais un certain nombre d’Africains, de la communauté blanche ou européenne.
Ça, c’est intéressant de voir un peu la perspective dans laquelle on peut être vu. Ça peut être un peu choquant, parfois, le livre, mais c’est quand même fort intéressant pour se nourrir de quelque chose pour lequel vous n’avez peut-être pas l’habitude. L’autre livre, c’est le livre que peut-être certains d’entre vous connaissez, mais je l’ai trouvé vraiment intéressant, c’est le livre de Philippe Longchamps qu’il a fait avec Charlotte Graham sur Transformative Education.
C’est vraiment, pour lui, toute la question d’une approche qui se veut davantage interdisciplinaire ou même transdisciplinaire, axée sur justement l’engagement des jeunes à des projets qui les entourent, et cetera. C’est aussi un livre que je trouve fort intéressant. Il est en anglais celui-ci, mais il a peut-être été traduit dernièrement. Je ne sais pas, il faudrait aller vérifier.
Louis : André, pour la conclusion, parce que j’ai trouvé que notre conversation a été vraiment très intéressante, puis je le savais que ce serait un bonheur pour moi, je te laisse la conclusion de ce balado.
André : La conclusion, je ne te mentirai pas, je l’ai un petit peu écrite. Je tiens à le dire.
Louis : Okay. [rires] Tu t’es préparé. Tu savais que ça s’en venait tout ça.
André : Oui, je me suis préparé. Tu m’avais dit qu’il était pour y avoir une conclusion, puis j’ai voulu faire une espèce de phrase que je trouvais importante. C’était : « L’éducation, j’ai trouvé que c’était un monde qui est passionnant pour découvrir puis comprendre notre société qui est en évolution, mais aussi pour grandir puis apprendre personnellement. » Je trouve que le monde de l’éducation, pour ceux qui s’y lancent, puis pour ceux qui y sont présents depuis un certain nombre d’années, c’est passionnant quand on le regarde dans l’esprit de la société qui évolue.
On travaille avec des jeunes, des adultes, des jeunes adultes qui sont enseignants, on peut voir comment notre société se transforme à travers une petite minisociété de jeunes. Ça, je trouve ça vraiment passionnant. C’est tellement un beau milieu pour grandir nous-mêmes comme être humain parce que tu es confronté constamment. Il n’y a pas grand milieux de travail où, tous les jours, tu es face à 30 jeunes ou 25 jeunes que tu accompagnes. Ça n’existe à peu près pas.
Tu fais une conférence de temps en temps, tu peux avoir des regroupements de temps en temps, mais 180 quelques jours, c’est quelque chose. Il faut profiter de cette minisociété-là pour grandir nous-mêmes, mais, en même temps, voir notre société qui évolue, puis qui se transforme.
Louis : André, il ne me reste juste qu’à te remercier pour ces belles paroles qui, je suis certain, vont faire réfléchir. Je te dis merci. Je suis certain qu’on va avoir un jour la chance de continuer cette conversation passionnante. Merci, André!
[musique]
Merci d’avoir écouté ce balado. Pour avoir accès aux autres balados de la série, visitez le site Internet du Centre franco. Vous pouvez aussi avoir accès aux différents balados sur Spotify. N’oubliez pas, enfin, qu’il est toujours possible de communiquer avec nous en utilisant l’adresse courriel suivante info@lecentrefranco.ca.
[musique]